|
|
|

|
|
2021 (vol. 21)
|
|
Un crinoïde paracomatulide probablement rampant du Jurassique inférieur d'Italie centrale
Riccardo MANNI & Rolando DI NARDO
| HTML  | PDF
| PDF  [725 KB]
| DOI: 10.2110/carnets.2021.2119 [725 KB]
| DOI: 10.2110/carnets.2021.2119
|
|
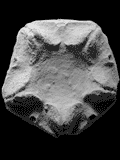 Résumé : Un nouveau crinoïde
paracomatulide, Tiburtocrinus toarcensis gen. et sp.
nov., est décrit dans le Jurassique inférieure de Tivoli (Apennins centraux,
Italie). Jamais
signalée jusqu'à present en Italie, cette découverte comble une lacune au
sein des descriptions de ce type de crinoïde sans tige. L'analyse
morphofonctionnelle de ses facettes radiales montre que Tiburtocrinus toarcensis
gen. et sp. nov. était probablement un paracomatulide rampant, très différent
des autres paracomatulides connus qui, eux, nageaient selon toute probabilité. Résumé : Un nouveau crinoïde
paracomatulide, Tiburtocrinus toarcensis gen. et sp.
nov., est décrit dans le Jurassique inférieure de Tivoli (Apennins centraux,
Italie). Jamais
signalée jusqu'à present en Italie, cette découverte comble une lacune au
sein des descriptions de ce type de crinoïde sans tige. L'analyse
morphofonctionnelle de ses facettes radiales montre que Tiburtocrinus toarcensis
gen. et sp. nov. était probablement un paracomatulide rampant, très différent
des autres paracomatulides connus qui, eux, nageaient selon toute probabilité.
|
|
Carnets Geol., vol. 21, nº 19, p. 383-390
En ligne depuis le 25 décembre 2021
|
|
Notice nomenclaturale, p.
234
|
|
Répartition biostratigraphique des orbitolinidés dans la biozonation à ammonites (plate-forme urgonienne du Sud-Est de la France). 2e partie : Barrémien p.p.
Bruno GRANIER, Bernard CLAVEL, Robert BUSNARDO, Jean CHAROLLAIS, Pierre DESJACQUES & Didier BERT
| HTML  | PDF
| PDF  [27.925 KB]
| DOI: 10.2110/carnets.2021.2118
[27.925 KB]
| DOI: 10.2110/carnets.2021.2118
|
|
 Résumé :
La répartition biostratigraphique des orbitolinidés du Barrémien présentée ci-dessous est calibrée sur la biozonation des ammonites. Ce travail est basé sur
l'étude de onze coupes de terrain qui ont livré des orbitolinidés de niveaux encadrés ou surmontés par des faciès à ammonites
et/ou à échinides significatifs sur le plan biostratigraphique. Résumé :
La répartition biostratigraphique des orbitolinidés du Barrémien présentée ci-dessous est calibrée sur la biozonation des ammonites. Ce travail est basé sur
l'étude de onze coupes de terrain qui ont livré des orbitolinidés de niveaux encadrés ou surmontés par des faciès à ammonites
et/ou à échinides significatifs sur le plan biostratigraphique.
|
|
Carnets Geol., vol. 21, nº 18, p. 399-521
En ligne depuis le 24 octobre 2021
|
|
L'ichnoespèce Linichnus bromleyi sur un radius de baleine à fanons miocène comportant de multiples traces de morsure-secouage de requin suggère son charognage
Stephen J. GODFREY & Annie J. LOWRY
| HTML  | PDF
| PDF  [508 KB]
| DOI: 10.2110/carnets.2021.2117 [508 KB]
| DOI: 10.2110/carnets.2021.2117
|
|
 Résumé : Un radius gauche isolé de baleine à fanons miocène a enregistré à
plusieurs reprises des traces de morsure-secouage de requin. Le radius provient
probablement du Plum Point Member de la Calvert Formation des Calvert Cliffs (Comté
de Calvert, Maryland, États-Unis d'Amérique). Au moins trois ensembles de
morsure-secouage successifs marquant ce radius et provenant de plusieurs dents sont attribués à la trace fossile Linichnus bromleyi. Ces traces de
morsure-secouage se composant de gouges peu profondes, fines et arquées sur le
radius indiquent vraisemblablement du charognage plutôt qu'une prédation
active. L'origine la plus probable de ce regroupement de L. bromleyi au
sein de chacun de ces trois ensembles de traces serait par le biais de morsures
répétées alors que le requin repositionne sa proie dans sa gueule ou, autre
possibilité, de morsures d'une espèce de requin dotée de plusieurs dents
fonctionnelles au sein même de sa rangée dentaire. Si les traces de morsure
sont produites par des dents non-crantées (comme cela semble être le cas),
alors le candidat le plus probable serait Carcharodon hastalis. Résumé : Un radius gauche isolé de baleine à fanons miocène a enregistré à
plusieurs reprises des traces de morsure-secouage de requin. Le radius provient
probablement du Plum Point Member de la Calvert Formation des Calvert Cliffs (Comté
de Calvert, Maryland, États-Unis d'Amérique). Au moins trois ensembles de
morsure-secouage successifs marquant ce radius et provenant de plusieurs dents sont attribués à la trace fossile Linichnus bromleyi. Ces traces de
morsure-secouage se composant de gouges peu profondes, fines et arquées sur le
radius indiquent vraisemblablement du charognage plutôt qu'une prédation
active. L'origine la plus probable de ce regroupement de L. bromleyi au
sein de chacun de ces trois ensembles de traces serait par le biais de morsures
répétées alors que le requin repositionne sa proie dans sa gueule ou, autre
possibilité, de morsures d'une espèce de requin dotée de plusieurs dents
fonctionnelles au sein même de sa rangée dentaire. Si les traces de morsure
sont produites par des dents non-crantées (comme cela semble être le cas),
alors le candidat le plus probable serait Carcharodon hastalis.
|
|
Carnets Geol., vol. 21, nº 17, p. 391-398
En ligne depuis le 24 octobre 2021
|
|
Corrigendum, p.
202 : Une erreur s'est glissée dans l'orthographe du nom de famille de l'un des artistes qui ont créé la Figure 2. L'orthographe correcte de son nom de famille est "Schumaker".
|
|
Nouveaux genres et espèces d'ostracodes du Bassin miocène d'El Ma El Abiod (Tébessa, NE de l'Algérie)
Francesco SCIUTO & Abdelhakim BENKHEDDA
| HTML  | PDF
| PDF  [932 KB]
| DOI: 10.2110/carnets.2021.2116 [932 KB]
| DOI: 10.2110/carnets.2021.2116
|
|
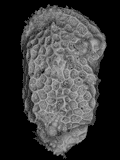 Résumé : Deux nouveaux genres d'ostracodes de la famille Trachyleberididae Sylvester-Bradley,
1948, chacun fondé sur une espèce nouvelle, sont
décrits et discutés dans cet article. Les spécimens proviennent de
sédiments tortoniens affleurant à El Hadjra Safra dans le
bassin d'El Ma El Abiod (région de Tébessa, nord-est de l'Algérie). Résumé : Deux nouveaux genres d'ostracodes de la famille Trachyleberididae Sylvester-Bradley,
1948, chacun fondé sur une espèce nouvelle, sont
décrits et discutés dans cet article. Les spécimens proviennent de
sédiments tortoniens affleurant à El Hadjra Safra dans le
bassin d'El Ma El Abiod (région de Tébessa, nord-est de l'Algérie).
|
|
Carnets Geol., vol. 21, nº 16, p. 383-390
En ligne depuis le 24 octobre 2021
|
|
Notice nomenclaturale, p.
180
|
|
La diversification précoce des Orbitolinidae au Berriasien supérieur : Nouvelles perspectives sur la taxonomie, l'origine, la diversification et la phylogénie de la famille basée sur des données de Serbie orientale
Felix SCHLAGINTWEIT & Ioan I. BUCUR
| HTML  | PDF
| PDF  [10.561 KB]
| DOI: 10.2110/carnets.2021.2115 [10.561 KB]
| DOI: 10.2110/carnets.2021.2115
|
|
 Résumé : De nouvelles données provenant des
Carpatho-Balkanides de Serbie orientale témoignent de premières apparitions "explosives"
plus ou moins simultanées de plusieurs genres d'Orbitolinidae dans le
Berriasien supérieur. Précédemment la plupart des taxons observés étaient
répertoriés dans des couches guère plus anciennes que l'Hauterivien
supérieur (= Urgonien classique du sud-est de la France), démontrant que
ces âges de première apparition n'ont de signification que localement. L'assemblage
diversifié de Serbie comporte des représentants des sous-familles
Dictyoconinae avec les genres Cribellopsis
Arnaud-Vanneau, Montseciella
Cherchi & Schroeder, Orbitolinopsis
Henson, Urgonina Foury
& Moullade, Valserina Schroeder
& Conrad et Vanneauina Schlagintweit,
et Praedictyorbitolininae avec le genre Paracoskinolina
Moullade. Aucun représentant des Orbitolininae (à
embryon complexe) n'a été observé, cette sous-famille apparaissant plus
tardivement dans le registre fossile, apparemment durant l'Hauterivien
supérieur-Barrémien inférieur. Au total, 17 taxons sont reconnus, parmi
lesquels trois sont laissés en nomenclature ouverte. Une nouvelle espèce est
décrite : Cribellopsis sudari n. sp. La majorité des espèces
observées montre des tests coniques moyens à hauts et un exosquelette plutôt
simple dépourvu de cloisonnettes horizontales ("rafters"). Les
nouvelles données contredisent une évolution phylogénétique des différents
genres montrant différentes structures internes de test se succédant dans le
temps (= relations ancêtre-descendant) comme certains auteurs le postulent.
L'explosion radiative ("diversification précoce") des Orbitolinidae au
Berriasien supérieur s'accompagne de l'événement de première apparition
(FAD) de plusieurs autres grands foraminifères benthiques comprenant des taxons
essentiellement agglutinants (e.g., Ammocycloloculina, Choffatella, Drevennia, Eclusia,
Moulladella, Pfenderina et
Pseudotextulariella) mais aussi porcelanés complexes (Pavlovcevina),
constituant la preuve d'un bio-événement majeur à cette époque qui dépasse
le nombre de taxons apparaissant dans les étages précédents (Tithonien) et
suivant (Valanginien). L'histoire évolutive initiale des Orbitolinidae peut
être considérée comme un exemple classique de radiation adaptative au sein de
l'histoire d'un clade. Résumé : De nouvelles données provenant des
Carpatho-Balkanides de Serbie orientale témoignent de premières apparitions "explosives"
plus ou moins simultanées de plusieurs genres d'Orbitolinidae dans le
Berriasien supérieur. Précédemment la plupart des taxons observés étaient
répertoriés dans des couches guère plus anciennes que l'Hauterivien
supérieur (= Urgonien classique du sud-est de la France), démontrant que
ces âges de première apparition n'ont de signification que localement. L'assemblage
diversifié de Serbie comporte des représentants des sous-familles
Dictyoconinae avec les genres Cribellopsis
Arnaud-Vanneau, Montseciella
Cherchi & Schroeder, Orbitolinopsis
Henson, Urgonina Foury
& Moullade, Valserina Schroeder
& Conrad et Vanneauina Schlagintweit,
et Praedictyorbitolininae avec le genre Paracoskinolina
Moullade. Aucun représentant des Orbitolininae (à
embryon complexe) n'a été observé, cette sous-famille apparaissant plus
tardivement dans le registre fossile, apparemment durant l'Hauterivien
supérieur-Barrémien inférieur. Au total, 17 taxons sont reconnus, parmi
lesquels trois sont laissés en nomenclature ouverte. Une nouvelle espèce est
décrite : Cribellopsis sudari n. sp. La majorité des espèces
observées montre des tests coniques moyens à hauts et un exosquelette plutôt
simple dépourvu de cloisonnettes horizontales ("rafters"). Les
nouvelles données contredisent une évolution phylogénétique des différents
genres montrant différentes structures internes de test se succédant dans le
temps (= relations ancêtre-descendant) comme certains auteurs le postulent.
L'explosion radiative ("diversification précoce") des Orbitolinidae au
Berriasien supérieur s'accompagne de l'événement de première apparition
(FAD) de plusieurs autres grands foraminifères benthiques comprenant des taxons
essentiellement agglutinants (e.g., Ammocycloloculina, Choffatella, Drevennia, Eclusia,
Moulladella, Pfenderina et
Pseudotextulariella) mais aussi porcelanés complexes (Pavlovcevina),
constituant la preuve d'un bio-événement majeur à cette époque qui dépasse
le nombre de taxons apparaissant dans les étages précédents (Tithonien) et
suivant (Valanginien). L'histoire évolutive initiale des Orbitolinidae peut
être considérée comme un exemple classique de radiation adaptative au sein de
l'histoire d'un clade.
|
|
Carnets Geol., vol. 21, nº 15, p. 343-382
En ligne depuis le 17 août 2021
|
|
Notice nomenclaturale, p.
136
|
|
Bivalves rudistes (Hippuritoidea) de la Formation du Calcaire de Clifton (Campanien inférieur) de Jamaïque occidentale et réexamen du genre Vaccinites aux Amériques
Simon F. MITCHELL
| HTML  | PDF
| PDF  [3.583 KB]
| DOI: 10.2110/carnets.2021.2114 [3.583 KB]
| DOI: 10.2110/carnets.2021.2114
|
|
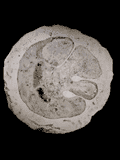 Résumé : La Formation du
Calcaire de Clifton en Jamaïque d'âge Campanien inférieur (Crétacé supérieur) renferme
trois espèces de bivalves hippuritides : Barrettia
ruseae Chubb, Whitfieldiella
luceae sp. nov. and Vaccinites
vermunti Mac Gillavry, et un plagioptychidé : Plagioptychus
sp. Les hippuritides sont décrits en détail au moyen de statistiques. Barrettia
ruseae est reconnue comme étant une espèce plus primitive de Barrettia
que B. monilifera Woodward ou B.
multilirata Whitfield, et l'espèce Whitfieldiella
luceae apparaît comme étant une espèce plus
primitive de Whitfieldiella que W.
gigas Chubb. Les spécimens de Vaccinites
du Calcaire de Clifton sont
comparés aux populations de Vaccinites
d'autres localités des Amériques, et cinq espèces (représentant
probablement une même lignée évolutive) sont reconnues : V.
alencasteri sp. nov. (Turonien supérieur ? - Coniacien ?), V.
martini Mac Gillavry (probablement Santonien inférieur à moyen), V.
macgillavryi Palmer (probablement Santonien moyen à supérieur), V.
vermunti Mac Gillavry (Campanien basal) et V.
temazcali sp. nov. (partie supérieure du Campanien inférieur). Les espèces
du genre Vaccinites peuvent être
caractérisées au moyen de techniques statistiques. Les âges du Clifton Limestone et des cinq espèces du genre Vaccinites sont révisés. Ce travail démontre l'utilité des
hippuritides en biostratigraphie pour le Crétacé supérieur des Amériques. Résumé : La Formation du
Calcaire de Clifton en Jamaïque d'âge Campanien inférieur (Crétacé supérieur) renferme
trois espèces de bivalves hippuritides : Barrettia
ruseae Chubb, Whitfieldiella
luceae sp. nov. and Vaccinites
vermunti Mac Gillavry, et un plagioptychidé : Plagioptychus
sp. Les hippuritides sont décrits en détail au moyen de statistiques. Barrettia
ruseae est reconnue comme étant une espèce plus primitive de Barrettia
que B. monilifera Woodward ou B.
multilirata Whitfield, et l'espèce Whitfieldiella
luceae apparaît comme étant une espèce plus
primitive de Whitfieldiella que W.
gigas Chubb. Les spécimens de Vaccinites
du Calcaire de Clifton sont
comparés aux populations de Vaccinites
d'autres localités des Amériques, et cinq espèces (représentant
probablement une même lignée évolutive) sont reconnues : V.
alencasteri sp. nov. (Turonien supérieur ? - Coniacien ?), V.
martini Mac Gillavry (probablement Santonien inférieur à moyen), V.
macgillavryi Palmer (probablement Santonien moyen à supérieur), V.
vermunti Mac Gillavry (Campanien basal) et V.
temazcali sp. nov. (partie supérieure du Campanien inférieur). Les espèces
du genre Vaccinites peuvent être
caractérisées au moyen de techniques statistiques. Les âges du Clifton Limestone et des cinq espèces du genre Vaccinites sont révisés. Ce travail démontre l'utilité des
hippuritides en biostratigraphie pour le Crétacé supérieur des Amériques.
|
|
Carnets Geol., vol. 21, nº 14, p. 315-341
En ligne depuis le 7 juillet 2021
|
|
Notice nomenclaturale, p. 342
|
|
Les céphalopodes du Kimméridgien et du Tithonien inférieur de la Formation du Calcaire de Kisújbánya, Zengővárkony (Massif du Mecsek, Hongrie méridionale), leur composition faunistique, leurs affinités paléobiogéographiques et leur caractéristiques taphonomiques
László BUJTOR, Richárd ALBRECHT, Csaba FARKAS, Bertalan MAKÓ, Dávid MARÓTI & Ákos MIKLÓSY
| HTML  | PDF
| PDF  [3.000 KB]
| DOI: 10.2110/carnets.2021.2113 [3.000 KB]
| DOI: 10.2110/carnets.2021.2113
|
|
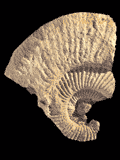 Résumé : Un nouvel échantillonnage
à Zengővárkony (Massif du Mecsek, Hongrie) a fourni un assemblage fossile dominé par les céphalopodes, riche et diversifié mais mal préservé, représentant le Kimméridgien et le
Tithonien inférieur. Le matériel provient d'un mélange d'éboulis, de sols et de racines, le tout ayant été exposés aux éléments pendant une longue période et affecté par les processus
d'altération. Le nautiloïde Pseudaganides strambergensis est signalé pour la première fois dans le Massif du Mecsek. En raison de l'altération, l'ammonitofaune consiste
principalement en des éléments fragmentés et dissous qui représentent 528 spécimens appartenant à 34 espèces et 30 genres parmi lesquels 20 espèces et 15 genres sont signalés pour la
première fois dans le Massif du Mecsek. La faune ne comporte que des spécimens de taxons déjà connus. Aucun nouveau taxon n'y est reconnu. En se fondant sur la comparaison avec d'autres
faunes, cet assemblage ressemble très fortement à la faune des Alpes vénitiennes (Italie). Des éléments faunistiques additionnels incluent des aptychi (Laevaptychus latus,
Lamellaptychus murocostatus), des bélemnites (Hibolithes semisulcatus) et un brachiopode indéterminé. Le premier signalement de Spiraserpula spirolinites, un
polychète fossile encroûtant conservé sur le moulage interne d'un fragment de coquille de Taramelliceras, indique des conditions de fond favorables à l'épifaune. La présence de
Aspidoceras caletanum, Gravesia aff. gigas et de Pseudowaagenia inerme indique des connexions avec la province sub-méditerranéenne de la Téthys, qui dans
le prolongement tectonique et paléogéographique de la Zone du Mecsek pendant le Jurassique supérieur. L'assemblage d'ammonites comporte des éléments de cinq ammonitozones téthysiennes
du Kimméridgien et du Tithonien. La Zone à Herbichi du Kimméridgien inférieur est indiquée par Streblites tenuilobatus et Praesimoceras herbichi. La Zone à Acanthicum du
Kimméridgien supérieur est caractérisée par Aspidoceras acanthicum, et la Zone à Cavouri par Mesosimoceras cavouri et Aspidoceras caletanum. La Zone à Beckeri du
Kimméridgien supérieur est suggérée par Hybonoticeras pressulum et Pseudowaagenia inerme, tandis que Gravesia aff. gigas, Lithacoceras aff.
siliceum et Malagasites ? denseplicatus sont des éléments faunistiques caractérisant la Zone à Hybonotum du Tithonien inférieur. Les spécimens de phyllocératides et de
lytocératides représentent seulement 12% de la faune, tandis que la majorité des spécimens appartient aux Oppeliidae et aux Ataxioceratidae (60%). Résumé : Un nouvel échantillonnage
à Zengővárkony (Massif du Mecsek, Hongrie) a fourni un assemblage fossile dominé par les céphalopodes, riche et diversifié mais mal préservé, représentant le Kimméridgien et le
Tithonien inférieur. Le matériel provient d'un mélange d'éboulis, de sols et de racines, le tout ayant été exposés aux éléments pendant une longue période et affecté par les processus
d'altération. Le nautiloïde Pseudaganides strambergensis est signalé pour la première fois dans le Massif du Mecsek. En raison de l'altération, l'ammonitofaune consiste
principalement en des éléments fragmentés et dissous qui représentent 528 spécimens appartenant à 34 espèces et 30 genres parmi lesquels 20 espèces et 15 genres sont signalés pour la
première fois dans le Massif du Mecsek. La faune ne comporte que des spécimens de taxons déjà connus. Aucun nouveau taxon n'y est reconnu. En se fondant sur la comparaison avec d'autres
faunes, cet assemblage ressemble très fortement à la faune des Alpes vénitiennes (Italie). Des éléments faunistiques additionnels incluent des aptychi (Laevaptychus latus,
Lamellaptychus murocostatus), des bélemnites (Hibolithes semisulcatus) et un brachiopode indéterminé. Le premier signalement de Spiraserpula spirolinites, un
polychète fossile encroûtant conservé sur le moulage interne d'un fragment de coquille de Taramelliceras, indique des conditions de fond favorables à l'épifaune. La présence de
Aspidoceras caletanum, Gravesia aff. gigas et de Pseudowaagenia inerme indique des connexions avec la province sub-méditerranéenne de la Téthys, qui dans
le prolongement tectonique et paléogéographique de la Zone du Mecsek pendant le Jurassique supérieur. L'assemblage d'ammonites comporte des éléments de cinq ammonitozones téthysiennes
du Kimméridgien et du Tithonien. La Zone à Herbichi du Kimméridgien inférieur est indiquée par Streblites tenuilobatus et Praesimoceras herbichi. La Zone à Acanthicum du
Kimméridgien supérieur est caractérisée par Aspidoceras acanthicum, et la Zone à Cavouri par Mesosimoceras cavouri et Aspidoceras caletanum. La Zone à Beckeri du
Kimméridgien supérieur est suggérée par Hybonoticeras pressulum et Pseudowaagenia inerme, tandis que Gravesia aff. gigas, Lithacoceras aff.
siliceum et Malagasites ? denseplicatus sont des éléments faunistiques caractérisant la Zone à Hybonotum du Tithonien inférieur. Les spécimens de phyllocératides et de
lytocératides représentent seulement 12% de la faune, tandis que la majorité des spécimens appartient aux Oppeliidae et aux Ataxioceratidae (60%).
|
|
Carnets Geol., vol. 21, nº 13, p. 265-314
En ligne depuis le 4 juillet 2021
|
|
Les nautiloïdes crétacés du genre Anglonautilus Spath, 1927, en France
Cyril BAUDOUIN, Gérard DELANOY, Jens LEHMANN, Camille FRAU, Roland GONNET & Jean VERMEULEN
| HTML  | PDF
| PDF  [4.157 KB]
| DOI: 10.2110/carnets.2021.2112 [4.157 KB]
| DOI: 10.2110/carnets.2021.2112
|
|
 Résumé : La répartition du genre Anglonautilus Spath en France était
jusqu'à présent limitée à la présence d'Anglonautilus
dorsoplicatus (Wiedmann) dans l'Albien
d'Escragnolles (Alpes-Maritimes) et d'Anglonautilus
sp. dans l'Aptien de Les Ferres (Alpes-Maritimes). Nous rapportons ici la présence des espèces successives Anglonautilus
praeundulatus Lehmann et al.,
Anglonautilus undulatus (Sowerby) et Anglonautilus dorsoplicatus (Wiedmann) dans le Crétacé de
France. Le genre Anglonautilus Spath, connu jusqu'alors
uniquement à partir de l'Aptien, est présent dès l'Hauterivien. L'espèce
hauterivienne Nautilus begudensis Kilian & Reboul,
parfois attribuée au genre Anglonautilus Spath, est révisée et
transférée au genre Cymatoceras Hyatt. Résumé : La répartition du genre Anglonautilus Spath en France était
jusqu'à présent limitée à la présence d'Anglonautilus
dorsoplicatus (Wiedmann) dans l'Albien
d'Escragnolles (Alpes-Maritimes) et d'Anglonautilus
sp. dans l'Aptien de Les Ferres (Alpes-Maritimes). Nous rapportons ici la présence des espèces successives Anglonautilus
praeundulatus Lehmann et al.,
Anglonautilus undulatus (Sowerby) et Anglonautilus dorsoplicatus (Wiedmann) dans le Crétacé de
France. Le genre Anglonautilus Spath, connu jusqu'alors
uniquement à partir de l'Aptien, est présent dès l'Hauterivien. L'espèce
hauterivienne Nautilus begudensis Kilian & Reboul,
parfois attribuée au genre Anglonautilus Spath, est révisée et
transférée au genre Cymatoceras Hyatt.
|
|
Carnets Geol., vol. 21, nº 12, p. 235-263
En ligne depuis le 24 juin 2021
|
|
Nouvel aperçu sur l'environnement de dépôt et la position stratigraphique de la Brèche de Gugu (Monts Pădurea Craiului, Roumanie)
Traian SUCIU, George PLEŞ, Tudor TĂMAŞ, Ioan I. BUCUR, Emanoil SĂSĂRAN & Ioan COCIUBA
| HTML  | PDF
| PDF  [3.293 KB]
| DOI: 10.2110/carnets.2021.2111 [3.293 KB]
| DOI: 10.2110/carnets.2021.2111
|
|
 Résumé : L'analyse des clastes carbonatés et de la matrice d'une
formation sédimentaire problématique, à savoir la Brèche de Gugu,
dans les Monts Pădurea Craiului, apporte des précisions quant à son
environnement de dépôt et sa position stratigraphique. Les microfaciès et
assemblages micropaléontologiques identifiés démontrent que tous les clastes
carbonatés échantillonnés dans la Brèche de Gugu représentent les
vestiges d'une plate-forme carbonatée démantelée de type Urgonien. L'âge
barrémien des clastes suggère que la position stratigraphic de la Brèche de Gugu
dans sa localité-type pourrait être Barrémien terminal-Aptien
basal, une donnée également soutenue par l'absence d'éléments provenant des
plates-formes carbonatées du Crétacé inférieur situées plus haut dans la
colonne stratigraphique (e.g., Aptien ou Albien) de l'Unité de Bihor.
Les observations sédimentologiques et la minéralogie de la matrice ont fourni
de nouveaux arguments en faveur de la reconnaissance d'apports terrigènes
pendant la mise en place de la Brèche de Gugu. Résumé : L'analyse des clastes carbonatés et de la matrice d'une
formation sédimentaire problématique, à savoir la Brèche de Gugu,
dans les Monts Pădurea Craiului, apporte des précisions quant à son
environnement de dépôt et sa position stratigraphique. Les microfaciès et
assemblages micropaléontologiques identifiés démontrent que tous les clastes
carbonatés échantillonnés dans la Brèche de Gugu représentent les
vestiges d'une plate-forme carbonatée démantelée de type Urgonien. L'âge
barrémien des clastes suggère que la position stratigraphic de la Brèche de Gugu
dans sa localité-type pourrait être Barrémien terminal-Aptien
basal, une donnée également soutenue par l'absence d'éléments provenant des
plates-formes carbonatées du Crétacé inférieur situées plus haut dans la
colonne stratigraphique (e.g., Aptien ou Albien) de l'Unité de Bihor.
Les observations sédimentologiques et la minéralogie de la matrice ont fourni
de nouveaux arguments en faveur de la reconnaissance d'apports terrigènes
pendant la mise en place de la Brèche de Gugu.
|
|
Carnets Geol., vol. 21, nº 11, p. 215-233
En ligne depuis le 24 juin 2021
|
|
Un autre "survivant miocène" thermophile du Pliocène italien : Une occurrence précoce de l'aigle de mer pélagique Aetobatus dans la région euro-méditerranéenne
Alberto COLLARETA, Marco MERELLA, Simone CASATI, Giovanni COLETTI & Andrea DI CENCIO
| HTML  | PDF
| PDF  [669 KB]
| DOI: 10.2110/carnets.2021.2110 [669 KB]
| DOI: 10.2110/carnets.2021.2110
|
|
 Résumé : Le genre
Aetobatus (Myliobatiformes : Aetobatidae) est un genre actuel de raies
aigles vivant dans les environnements tropicaux et subtropicaux marins peu
profonds des océans Atlantique, Pacifique et Indien. De nos jours, Aetobatus
n'habite plus les eaux tempérées de l'Europe et de la Méditerranée, bien
qu'il soit connu dans cette vaste région par le recensement de plusieurs dents
fossiles dont la distribution chronostratigraphique s'étale du Paléogène
inférieur au Néogène supérieur. Le présent article décrit une dent fossile
d'Aetobatidae, identifiée comme appartenant à †Aetobatus cf. cappettai,
découverte dans les dépôts marins du Pliocène moyen (3,82-3,19 Ma, Zancléen
supérieur - Piacenzien inférieur) affleurant dans les environs de Certaldo
(Toscane, Italie). Ce spécimen représente l'occurrence la plus récente d'Aetobatus
le long des côtes d'Europe continentale ; en outre, avec les découvertes
antérieures de gisements plus ou moins contemporains de Majorque (Baléares,
Espagne), il représente l'enregistrement fossile le plus récent de ce genre
dans toute la région euro-méditerranéenne. Compte tenu des préférences
environnementales des espèces actuelles d'Aetobatus, notre découverte
évoque des conditions paléo-environnementales favorables à la persistance de
taxons "survivants miocènes" à affinités tropicales/subtropicales le long des côtes du Pliocène
de la Toscane. En outre, cela soulève la question de savoir si la crise de
salinité messinienne a abouti ou non à l'effondrement complet du biote marin méditerranéen
et à la recolonisation ultérieure de ce bassin à partir des eaux atlantiques
voisines et/ou des refuges intra-bassinaux marginaux dispersés au début du
Pliocène. La possibilité de recoloniser la mer Méditerranée à travers le
canal de Suez dans un futur proche est enfin discutée pour ce qui concerne le
genre Aetobatus. Résumé : Le genre
Aetobatus (Myliobatiformes : Aetobatidae) est un genre actuel de raies
aigles vivant dans les environnements tropicaux et subtropicaux marins peu
profonds des océans Atlantique, Pacifique et Indien. De nos jours, Aetobatus
n'habite plus les eaux tempérées de l'Europe et de la Méditerranée, bien
qu'il soit connu dans cette vaste région par le recensement de plusieurs dents
fossiles dont la distribution chronostratigraphique s'étale du Paléogène
inférieur au Néogène supérieur. Le présent article décrit une dent fossile
d'Aetobatidae, identifiée comme appartenant à †Aetobatus cf. cappettai,
découverte dans les dépôts marins du Pliocène moyen (3,82-3,19 Ma, Zancléen
supérieur - Piacenzien inférieur) affleurant dans les environs de Certaldo
(Toscane, Italie). Ce spécimen représente l'occurrence la plus récente d'Aetobatus
le long des côtes d'Europe continentale ; en outre, avec les découvertes
antérieures de gisements plus ou moins contemporains de Majorque (Baléares,
Espagne), il représente l'enregistrement fossile le plus récent de ce genre
dans toute la région euro-méditerranéenne. Compte tenu des préférences
environnementales des espèces actuelles d'Aetobatus, notre découverte
évoque des conditions paléo-environnementales favorables à la persistance de
taxons "survivants miocènes" à affinités tropicales/subtropicales le long des côtes du Pliocène
de la Toscane. En outre, cela soulève la question de savoir si la crise de
salinité messinienne a abouti ou non à l'effondrement complet du biote marin méditerranéen
et à la recolonisation ultérieure de ce bassin à partir des eaux atlantiques
voisines et/ou des refuges intra-bassinaux marginaux dispersés au début du
Pliocène. La possibilité de recoloniser la mer Méditerranée à travers le
canal de Suez dans un futur proche est enfin discutée pour ce qui concerne le
genre Aetobatus.
|
|
Carnets Geol., vol. 21, nº 10, p. 203-214
En ligne depuis le 24 juin 2021
|
|
Le Projet Kalkowsky
- Chapitre I. La relation ooïde - stromatoïde dans un stromatolithe de la
Formation Maiz Gordo (Argentine)
Bruno R.C. GRANIER & Philippe LAPOINTE
| HTML  | PDF
| PDF  [1.400 KB]
| DOI: 10.2110/carnets.2021.2109 [1.400 KB]
| DOI: 10.2110/carnets.2021.2109
|
|
 Résumé : L'étude
comparative d'oolithes et de stromatolithes démontre des similitudes frappantes
entre le matériel triasique allemand de Kalkowsky (d'après des
informations disponibles dans la littérature scientifique) et notre matériel
paléogène argentin. Cependant, ce dernier est mieux à même d'illustrer
qu'ooïdes et stromatoïdes, donc oolithes et stromatolithes, qui partagent la même
nature duale, organique et minérale, ne sont que les membres extrêmes d'un
ensemble de structures carbonatées d'origine microbienne. Résumé : L'étude
comparative d'oolithes et de stromatolithes démontre des similitudes frappantes
entre le matériel triasique allemand de Kalkowsky (d'après des
informations disponibles dans la littérature scientifique) et notre matériel
paléogène argentin. Cependant, ce dernier est mieux à même d'illustrer
qu'ooïdes et stromatoïdes, donc oolithes et stromatolithes, qui partagent la même
nature duale, organique et minérale, ne sont que les membres extrêmes d'un
ensemble de structures carbonatées d'origine microbienne.
|
|
Carnets Geol., vol. 21, nº 9, p. 193-201
En ligne depuis le 14 juin 2021
|
|
Ostracodes messiniens du Détroit Bétique occidental (Sud-Ouest de l'Espagne)
Verónica ROMERO, Francisco RUIZ, María Luz GONZÁLEZ-REGALADO, Josep TOSQUELLA, Manuel ABAD, Tatiana IZQUIERDO, Antonio TOSCANO & Paula GÓMEZ
| HTML  | PDF
| PDF  [620 KB]
| DOI: 10.2110/carnets.2021.2108 [620 KB]
| DOI: 10.2110/carnets.2021.2108
|
|
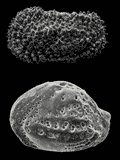 Résumé : Au Néogène, le Détroit Bétique est l'un des passages entre l'Océan Atlantique et la Mer Méditerranée. Dans cet article, nous analysons les faunes d'ostracodes provenant d'un forage réalisé dans le sud-ouest de l'Espagne et, plus précisément, situé sur le trajet du détroit. Ce forage a traversé des sédiments déposés au cours de la période immédiatement antérieure à la crise de salinité messinienne. Au cours du Messinien moyen (6,8-6,0 Ma), les associations d'ostracodes, rares et peu diversifiés (Krithe, Parakrithe, Henryhowella), sont typiques de paléo-environnements bathyaux supérieurs (de 200 à 400 m de profondeur). Cette période comprend une courte transition (6,26-6,25 Ma) jusqu'à des paléo-environnements néritiques externes. Elle coïncide avec un épisode de glaciation et l'association est caractérisée par la présence d'Acanthocythereis hystrix (Reuss, 1850) et la disparition des genres Krithe et Parakrithe. Les espèces les plus fréquentes ont une large distribution biostratigraphique, la plupart étant présentes du Tortonien à l'Holocène. Résumé : Au Néogène, le Détroit Bétique est l'un des passages entre l'Océan Atlantique et la Mer Méditerranée. Dans cet article, nous analysons les faunes d'ostracodes provenant d'un forage réalisé dans le sud-ouest de l'Espagne et, plus précisément, situé sur le trajet du détroit. Ce forage a traversé des sédiments déposés au cours de la période immédiatement antérieure à la crise de salinité messinienne. Au cours du Messinien moyen (6,8-6,0 Ma), les associations d'ostracodes, rares et peu diversifiés (Krithe, Parakrithe, Henryhowella), sont typiques de paléo-environnements bathyaux supérieurs (de 200 à 400 m de profondeur). Cette période comprend une courte transition (6,26-6,25 Ma) jusqu'à des paléo-environnements néritiques externes. Elle coïncide avec un épisode de glaciation et l'association est caractérisée par la présence d'Acanthocythereis hystrix (Reuss, 1850) et la disparition des genres Krithe et Parakrithe. Les espèces les plus fréquentes ont une large distribution biostratigraphique, la plupart étant présentes du Tortonien à l'Holocène.
|
|
Carnets Geol., vol. 21, nº 8, p. 181-192
En ligne depuis le 1 avril 2021
|
|
Brachiopodes jurassiens de l'intervalle Valanginien – Hauterivien. Leur contribution à la datation de la Formation de Salima au Mont Liban
Yves ALMÉRAS, Serge FERRY, Bruno R.C. GRANIER & Yann MERRAN
| HTML  | PDF
| PDF  [1.734 KB]
| DOI: 10.2110/carnets.2021.2107 [1.734 KB]
| DOI: 10.2110/carnets.2021.2107
|
|
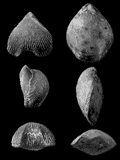 Résumé : Les gisements jurassiens français ou suisses du Crétacé basal
(Valanginien ou Hauterivien) recèlent de nombreuses espèces de brachiopodes
parmi lesquelles 3 espèces inconnues
au Liban : Lamellaerhynchia desori (Loriol in Pictet
& Campiche, 1872), Sulcirhynchia valangiensis (Loriol,
1864) et Terebratulina arzierensis (Loriol, 1864).
Le site fossilifère de la Formation
de Salima à Zeghrine, une localité proche de Bikfaya (Mont Liban), recèle une
association constituée de Belothyris
pseudojurensis (Leymerie, 1842), Lamellaerhynchia
hauteriviensis Burri, 1953,
Loriolithyris valdensis (Loriol, 1868), Lor. latifrons (Pictet,
1872), Sellithyris carteroniana (Orbigny,
1847) et Terebratulina
biauriculata Orbigny, 1850, toutes également présentes dans les
localités jurassiennes. Sur la base de l'étude de
son association de brachiopodes, la
Formation de Salima est par conséquent attribuée au Valanginien
indifférencié. Résumé : Les gisements jurassiens français ou suisses du Crétacé basal
(Valanginien ou Hauterivien) recèlent de nombreuses espèces de brachiopodes
parmi lesquelles 3 espèces inconnues
au Liban : Lamellaerhynchia desori (Loriol in Pictet
& Campiche, 1872), Sulcirhynchia valangiensis (Loriol,
1864) et Terebratulina arzierensis (Loriol, 1864).
Le site fossilifère de la Formation
de Salima à Zeghrine, une localité proche de Bikfaya (Mont Liban), recèle une
association constituée de Belothyris
pseudojurensis (Leymerie, 1842), Lamellaerhynchia
hauteriviensis Burri, 1953,
Loriolithyris valdensis (Loriol, 1868), Lor. latifrons (Pictet,
1872), Sellithyris carteroniana (Orbigny,
1847) et Terebratulina
biauriculata Orbigny, 1850, toutes également présentes dans les
localités jurassiennes. Sur la base de l'étude de
son association de brachiopodes, la
Formation de Salima est par conséquent attribuée au Valanginien
indifférencié.
|
|
Carnets Geol., vol. 21, nº 7, p. 163-179
En ligne depuis le 24 mars 2021
|
|
Premier enregistrement des modifications paléo-océanograhiques et paléo-climatologiques au Campanien supérieur, Plate-Forme Arabe, secteur de Mazidag-Mardin area, Turquie du sud-est
İsmail Ömer YILMAZ, Izzet HOŞGÖR, Sevinç ÖZKAN-ALTINER, Michael WAGREICH & Jiří KVAČEK
| HTML  | PDF
| PDF  [1.897 KB]
| DOI: 10.2110/carnets.2021.2106 [1.897 KB]
| DOI: 10.2110/carnets.2021.2106
|
|
 Résumé : La
sédimentologie, la géochimie et la paléontologie des dépôts pélagiques
d'âge Campanien supérieur à Maastrichtien de la Formation de Bozova
illustrent pour la première fois les changements paléo-océanographiques dans
le secteur de Mazıdağı-Mardin, Turquie du sud-est. La coupe stratigraphique
composite, épaisse de 119,25 m, est constituée d'alternances de marnes,
calcaires marneux, argiles et argiles noires ("black shales") ; aucun mélange
grossier silicoclastique ou intercalation de turbidite n'a été
observé dans la coupe. Les données biostratigraphiques indiquent la présence
de la Zone à Radotruncana calcarata
et des zones de nannofossiles UC15de/UC16. Les analyses géochimiques
d'isotopes stables et d'éléments-traces ont été effectuées sur la coupe
étudiée. Les courbes isotopiques résultantes montrent des variations similaires
aux courbes de référence des bassins européens et chinois pour la même
période. L'excursion principale négative en isotopes du carbone reconnue dans
l'intervalle supérieur peut être corrélée avec l'Événement du Campanien
supérieur. Les éléments-traces montrent de manière générale deux tendances
haussières relatives de la productivité dans la partie inférieure et la
partie moyenne de la succession lithologique. La partie inférieure de la coupe
montre des conditions relativement plus dysoxiques/anoxiques et coïncide avec
les niveaux habituels de "black shales". Résumé : La
sédimentologie, la géochimie et la paléontologie des dépôts pélagiques
d'âge Campanien supérieur à Maastrichtien de la Formation de Bozova
illustrent pour la première fois les changements paléo-océanographiques dans
le secteur de Mazıdağı-Mardin, Turquie du sud-est. La coupe stratigraphique
composite, épaisse de 119,25 m, est constituée d'alternances de marnes,
calcaires marneux, argiles et argiles noires ("black shales") ; aucun mélange
grossier silicoclastique ou intercalation de turbidite n'a été
observé dans la coupe. Les données biostratigraphiques indiquent la présence
de la Zone à Radotruncana calcarata
et des zones de nannofossiles UC15de/UC16. Les analyses géochimiques
d'isotopes stables et d'éléments-traces ont été effectuées sur la coupe
étudiée. Les courbes isotopiques résultantes montrent des variations similaires
aux courbes de référence des bassins européens et chinois pour la même
période. L'excursion principale négative en isotopes du carbone reconnue dans
l'intervalle supérieur peut être corrélée avec l'Événement du Campanien
supérieur. Les éléments-traces montrent de manière générale deux tendances
haussières relatives de la productivité dans la partie inférieure et la
partie moyenne de la succession lithologique. La partie inférieure de la coupe
montre des conditions relativement plus dysoxiques/anoxiques et coïncide avec
les niveaux habituels de "black shales".
La présence conjointe de foraminifères planctoniques et
de nannofossiles calcaires diversifiés dans l'intervalle étudié indique un
environnement marin océanique téthysien de basse latitude et d'eaux chaudes.
De plus, les fossiles de plantes provenant de la masse continentale voisine
indiquent un climat tropical humide similaire à celui de l'actuelle Australie
nord-orientale. Par conséquent, des conditions atmosphériques tropicales
humides et d'eaux chaudes se sont développées dans la zone d'étude
provoquant une hausse de la productivité, des précipitations et le transport
de débris végétaux jusqu'aux environnements marins du grand large.Des
traces fossiles bio-érosives (perforations) sont décrites pour la première
fois en Algérie. Trois ichnotaxons observés dans des coquilles d'Ostrea
lamellosa du Messinien inférieur (Miocène terminal) du bassin de la Tafna
sont décrits. Ces derniers sont attribués à Entobia cf. geometrica, Gastrochaenolites
cf. torpedo et Trypanites isp.. Les coquilles d'Ostrea
lamellosa sont encroûtées par des balanidés eux-mêmes perforés par Trypanites
isp.. L'ichnoassemblage étudié est attribué à l'ichnofaciès à Trypanites.
En outre, la bio-érosion et l'encroûtement décrits ici permettent
l'identification des différentes phases de la transgression messinienne sur
le haut-fond de Souk el Khemis.
|
|
Carnets Geol., vol. 21, nº 6, p. 137-162
En ligne depuis le 24 mars 2021
|
|
Bioérosion des coquilles d'Ostrea lamellosa du Messinien du bassin de la Tafna (NO Algérie)
Mohammed N. NAIMI, Olev VINN & Amine CHERIF
| HTML  | PDF
| PDF  [1.139 KB]
| DOI: 10.2110/carnets.2021.2105 [1.139 KB]
| DOI: 10.2110/carnets.2021.2105
|
|
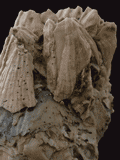 Résumé : Des
traces fossiles bio-érosives (perforations) sont décrites pour la première
fois en Algérie. Trois ichnotaxons observés dans des coquilles d'Ostrea
lamellosa du Messinien inférieur (Miocène terminal) du bassin de la Tafna
sont décrits. Ces derniers sont attribués à Entobia cf. geometrica, Gastrochaenolites
cf. torpedo et Trypanites isp.. Les coquilles d'Ostrea
lamellosa sont encroûtées par des balanidés eux-mêmes perforés par Trypanites
isp.. L'ichnoassemblage étudié est attribué à l'ichnofaciès à Trypanites.
En outre, la bio-érosion et l'encroûtement décrits ici permettent
l'identification des différentes phases de la transgression messinienne sur
le haut-fond de Souk el Khemis. Résumé : Des
traces fossiles bio-érosives (perforations) sont décrites pour la première
fois en Algérie. Trois ichnotaxons observés dans des coquilles d'Ostrea
lamellosa du Messinien inférieur (Miocène terminal) du bassin de la Tafna
sont décrits. Ces derniers sont attribués à Entobia cf. geometrica, Gastrochaenolites
cf. torpedo et Trypanites isp.. Les coquilles d'Ostrea
lamellosa sont encroûtées par des balanidés eux-mêmes perforés par Trypanites
isp.. L'ichnoassemblage étudié est attribué à l'ichnofaciès à Trypanites.
En outre, la bio-érosion et l'encroûtement décrits ici permettent
l'identification des différentes phases de la transgression messinienne sur
le haut-fond de Souk el Khemis.
|
|
Carnets Geol., vol. 21, nº 5, p. 127-135
En ligne depuis le 28 février 2021
|
|
Les bélemnites néocomiennes méditerranéennes,
5e partie : Distribution temporelle et zonation du Valanginien (avec quelques
remarques sur la lithologie)
Nico M.M. JANSSEN
| HTML  | PDF
| PDF  [5.238 KB]
| DOI: 10.2110/carnets.2021.2104 [5.238 KB]
| DOI: 10.2110/carnets.2021.2104
|
|
 Résumé : Une zonation établie sur la distribution temporelle
des bélemnites est
présentée pour le Valanginien et ses limites. Elle est calibrée sur des
coupes du bassin pré-vocontien (sud-est de la France) datées par ammonites et
corrélées banc par banc. Trois coupes inédites sont présentées ici. Ce sont
au total sept zones et six sous-zones qui
sont proposées ici. De plus, les différences concernant la répartition
spatiale des bélemnites sont analysées au sein du domaine vocontien ainsi que
dans d'autres régions (Bulgarie, Crimée, Espagne, France, Hongrie, Maroc,
Roumanie, Slovaquie, Suisse, Tchèquie). Enfin, deux addenda présentent des remarques concernant
certaines particularités lithologiques. Résumé : Une zonation établie sur la distribution temporelle
des bélemnites est
présentée pour le Valanginien et ses limites. Elle est calibrée sur des
coupes du bassin pré-vocontien (sud-est de la France) datées par ammonites et
corrélées banc par banc. Trois coupes inédites sont présentées ici. Ce sont
au total sept zones et six sous-zones qui
sont proposées ici. De plus, les différences concernant la répartition
spatiale des bélemnites sont analysées au sein du domaine vocontien ainsi que
dans d'autres régions (Bulgarie, Crimée, Espagne, France, Hongrie, Maroc,
Roumanie, Slovaquie, Suisse, Tchèquie). Enfin, deux addenda présentent des remarques concernant
certaines particularités lithologiques.
|
|
Carnets Geol., vol. 21, nº 4, p. 67-126
En ligne depuis le 28 février 2021
|
|
Révision d'Ostrea (Gigantostrea) gigantica Solander var. oligoplana Sacco et d'Ostrea (Ostrea) isseli Rovereto (Oligocène, Bassin tertiaire du Piémont, NO Italie)
Maria Cristina BONCI, Davide DAGNINO, Andrea MANDARINO, Aaron MAZZINI & Michele PIAZZA
| HTML  | PDF
| PDF  [1.573 KB]
| DOI: 10.2110/carnets.2021.2103 [1.573 KB]
| DOI: 10.2110/carnets.2021.2103
|
|
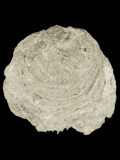 Résumé : L'objectif
du présent travail est la révision et la nouvelle illustration d' Ostrea(Gigantostrea) gigantica Solander
var. oligoplana Sacco, 1897,
d'Ostrea (Ostrea) isseli n. denom. Rovereto,
1897, et d'Ostrea (Ostrea) isseli n. denom. var. elongata
Rovereto, 1897. Ces taxons proviennent des couches oligocènes de la Formation de Molare
(bassin tertiaire du Piémont, Piémont méridional - Ligurie centrale, Italie du
nord-ouest). Les
syntypes d'O. (G.)
gigantica var. oligoplana figurent
dans la collection Bellardi et Sacco du Musée Régional de Sciences
Naturelles de Turin ; les syntypes d'O.
(O.)
isseli et d'O. (O.)
isseli var. elongata font partie de la collection BTP (Département de Sciences
de la Terre, de l'Environnement et de la Vie - DISTAV - Université de Gènes).
La variété oligoplana est ici élevée
au rang d'espèce et attribuée au genre Pycnodonte
Fischer von Waldheim, 1835. O. (O.)
isseli et O. (O.)
isseli var. elongata sont ici
considérées des synonymes juniors du taxon de Sacco. Rovereto
a comparé sa nouvelle espèce à Ostrea
subgigantea Raulin & Delbos,
1855, un taxon peu connu qui
est figuré ici pour la première fois et considéré comme représentant
une espèce distincte de P. oligoplana
(Sacco, 1897). Résumé : L'objectif
du présent travail est la révision et la nouvelle illustration d' Ostrea(Gigantostrea) gigantica Solander
var. oligoplana Sacco, 1897,
d'Ostrea (Ostrea) isseli n. denom. Rovereto,
1897, et d'Ostrea (Ostrea) isseli n. denom. var. elongata
Rovereto, 1897. Ces taxons proviennent des couches oligocènes de la Formation de Molare
(bassin tertiaire du Piémont, Piémont méridional - Ligurie centrale, Italie du
nord-ouest). Les
syntypes d'O. (G.)
gigantica var. oligoplana figurent
dans la collection Bellardi et Sacco du Musée Régional de Sciences
Naturelles de Turin ; les syntypes d'O.
(O.)
isseli et d'O. (O.)
isseli var. elongata font partie de la collection BTP (Département de Sciences
de la Terre, de l'Environnement et de la Vie - DISTAV - Université de Gènes).
La variété oligoplana est ici élevée
au rang d'espèce et attribuée au genre Pycnodonte
Fischer von Waldheim, 1835. O. (O.)
isseli et O. (O.)
isseli var. elongata sont ici
considérées des synonymes juniors du taxon de Sacco. Rovereto
a comparé sa nouvelle espèce à Ostrea
subgigantea Raulin & Delbos,
1855, un taxon peu connu qui
est figuré ici pour la première fois et considéré comme représentant
une espèce distincte de P. oligoplana
(Sacco, 1897).
|
|
Carnets Geol., vol. 21, nº 3, p. 55-66
En ligne depuis le 24 février 2021
|
|
Révision systématique et évolution de la famille tithonienne des Chitinoidellidae Trejo, 1975
Mohamed BENZAGGAGH
| HTML  | PDF
| PDF  [1.884 KB]
| DOI: 10.2110/carnets.2021.2102 [1.884 KB]
| DOI: 10.2110/carnets.2021.2102
|
|
 Résumé : Plusieurs nouveaux genres et espèces de la famille des Chitinoidellidae Trejo,
1975, ont été créés
par Pop (1997, 1998a, 1998b). Certains de ces taxons sont justifiés, mais d'autres sont mal définis et nécessitent une révision. Je discute ici la
non-validité de certains taxons et je propose une nouvelle classification systématique et un cadre évolutif pour la famille des Chitinoidellidae, avec deux sous-familles :
1) Dobeninae, qui regroupe des chitinoïdelles de petite taille, avec les genres Borziella Pop,
1997, Carpathella Pop, 1998a, Daciella Pop,
1998a (amendé), Dobenilla n. gen. et Popiella Reháková,
2002, et
2) Bonetinae, qui regroupe des chitinoïdelles de plus grande taille, avec les genres Bermudeziella n. gen., Bonetilla n. gen. et Furrazolaia n. gen.. Ces deux sous-familles sont séparées dans le temps. Les espèces de petite taille de la sous-famille des Dobeninae caractérisent la Sous-Zone à Dobeni (Zone à Ponti des ammonites) et disparaissent immédiatement avant l'apparition des spécimens de plus grande taille de la sous-famille des Bonetinae qui, quant à eux, caractérisent la Sous-Zone à Boneti (Zone à Microcanthum p.p. des ammonites). Résumé : Plusieurs nouveaux genres et espèces de la famille des Chitinoidellidae Trejo,
1975, ont été créés
par Pop (1997, 1998a, 1998b). Certains de ces taxons sont justifiés, mais d'autres sont mal définis et nécessitent une révision. Je discute ici la
non-validité de certains taxons et je propose une nouvelle classification systématique et un cadre évolutif pour la famille des Chitinoidellidae, avec deux sous-familles :
1) Dobeninae, qui regroupe des chitinoïdelles de petite taille, avec les genres Borziella Pop,
1997, Carpathella Pop, 1998a, Daciella Pop,
1998a (amendé), Dobenilla n. gen. et Popiella Reháková,
2002, et
2) Bonetinae, qui regroupe des chitinoïdelles de plus grande taille, avec les genres Bermudeziella n. gen., Bonetilla n. gen. et Furrazolaia n. gen.. Ces deux sous-familles sont séparées dans le temps. Les espèces de petite taille de la sous-famille des Dobeninae caractérisent la Sous-Zone à Dobeni (Zone à Ponti des ammonites) et disparaissent immédiatement avant l'apparition des spécimens de plus grande taille de la sous-famille des Bonetinae qui, quant à eux, caractérisent la Sous-Zone à Boneti (Zone à Microcanthum p.p. des ammonites).
|
|
Carnets Geol., vol. 21, nº 2, p. 27-53
En ligne depuis le 15 février 2021
|
|
Notice nomenclaturale, p. 54
|
|
Apianella nom. nov. (Dasycladales, Triploporellaceae) : Nouveau nom pour le genre algaire Apinella Granier et al., 1986, préoccupé
Bruno GRANIER & François MICHAUD
| PDF  [123 KB]
| DOI: 10.2110/carnets.2021.21NN1 [123 KB]
| DOI: 10.2110/carnets.2021.21NN1
|
|
Carnets Geol., vol. 21, Notice nomenclaturale 1, p. 26
En ligne depuis le 21 janvier 2021
|
|
Bacinella, un type particulier de structure calcimicrobienne mésozoïque
Bruno R.C. GRANIER
| HTML  | PDF
| PDF  [3.800 KB]
| DOI: 10.2110/carnets.2021.2101 [3.800 KB]
| DOI: 10.2110/carnets.2021.2101
|
|
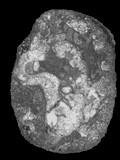 Résumé : La controverse entourant Bacinella
irregularis Radoičić, 1959,
et Lithocodium aggregatum Elliott, 1956, a fait s'opposer
sédimentologues et paléontologues. Les arguments pour les exclure des Codiaceae sont passés en revue.
Ces mêmes arguments peuvent également être avancés pour réfuter leur attribution à la plupart des autres
groupes d'organismes. La seule hypothèse qui résiste alors à tous ces éléments de réfutation est celle d'une
association impliquant des communautés microbiennes. En conséquence, ces structures sont ici traitées comme des structures biosédimentaires, à savoir des structures
bacinellae, et non comme des taxons. L'une des caractéristiques propres aux organismes
responsables de ces structures bacinellae est leur forte capacité de corrosion, comme en témoignent des exemples de fossiles partiellement ou totalement cannibalisés. Cette cannibalisation représente un état de corrosion au-delà de l'altération de surface et des perforations. Outre leur capacité à corroder
les substrats calcaires, ces organismes microbiens sont capables de former des nodules ou des oncoïdes,
voire même des biostromes qui, selon leur stade de développement, peuvent constituer des substrats
mous, fermes, voire durs. Cependant, dans l'état actuel de nos connaissances, les communautés microbiennes contribuant
à ces structures bacinellae n'ont jamais construit de bioherme. Pour compléter ce tour
d'horizon synthétique, un modèle de construction rassemblant de manière
cohérente la plupart des variantes architecturales est présenté. Quant au foraminifère endolithique
Troglotella incrustans, fréquemment associé aux structures bacinellae, ce n'est ni
un organisme encroûtant, ni un perforant. Enfin, contrairement à certaines hypothèses erronées, aucun épisode majeur à
bacinellae n'a jamais été observé à la suite d'un Événement Anoxique Océanique significatif. Résumé : La controverse entourant Bacinella
irregularis Radoičić, 1959,
et Lithocodium aggregatum Elliott, 1956, a fait s'opposer
sédimentologues et paléontologues. Les arguments pour les exclure des Codiaceae sont passés en revue.
Ces mêmes arguments peuvent également être avancés pour réfuter leur attribution à la plupart des autres
groupes d'organismes. La seule hypothèse qui résiste alors à tous ces éléments de réfutation est celle d'une
association impliquant des communautés microbiennes. En conséquence, ces structures sont ici traitées comme des structures biosédimentaires, à savoir des structures
bacinellae, et non comme des taxons. L'une des caractéristiques propres aux organismes
responsables de ces structures bacinellae est leur forte capacité de corrosion, comme en témoignent des exemples de fossiles partiellement ou totalement cannibalisés. Cette cannibalisation représente un état de corrosion au-delà de l'altération de surface et des perforations. Outre leur capacité à corroder
les substrats calcaires, ces organismes microbiens sont capables de former des nodules ou des oncoïdes,
voire même des biostromes qui, selon leur stade de développement, peuvent constituer des substrats
mous, fermes, voire durs. Cependant, dans l'état actuel de nos connaissances, les communautés microbiennes contribuant
à ces structures bacinellae n'ont jamais construit de bioherme. Pour compléter ce tour
d'horizon synthétique, un modèle de construction rassemblant de manière
cohérente la plupart des variantes architecturales est présenté. Quant au foraminifère endolithique
Troglotella incrustans, fréquemment associé aux structures bacinellae, ce n'est ni
un organisme encroûtant, ni un perforant. Enfin, contrairement à certaines hypothèses erronées, aucun épisode majeur à
bacinellae n'a jamais été observé à la suite d'un Événement Anoxique Océanique significatif.
|
|
Carnets Geol., vol. 21, nº 1, p. 1-25
En ligne depuis le 21 janvier 2021
|
|
|
|