|
|
|

|
|
2020 (vol. 20)
|
|
La biosignature de la sparite permet de distinguer un ciment gravitationnel des endostromatolithes
Bruno R.C. GRANIER
| HTML  | PDF
| PDF  [2.953 KB]
| DOI : 10.2110/carnets.2020.2020 [2.953 KB]
| DOI : 10.2110/carnets.2020.2020
|
|
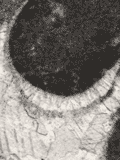 Résumé : Après à un bref rappel de quelques principes
fondamentaux de la sédimentologie (pétrographie sédimentaire) des carbonates
qui met en évidence l'importance de la matière organique, quelques
exemples de biocristaux dans les grains calcaires, tels que les bioclastes ou
les ooïdes, sont présentés dans un chapitre d'introduction à une discussion
portant sur la distinction entre ciments gravitationnels et endostromatolithes.
Les ciments gravitationnels, qu'ils soient marins (fibreux) ou continentaux (en "dents de chien"), sont constitués de cristaux sparitiques
hyalins (c'est-à-dire translucides) tandis que les endostromatolithes sont
constitués de cristaux sparitiques colorés et /ou de micrite. Les
ciments gravitationnels se forment dans la zone vadose alors que les
endostromatolithes poussent probablement dans de petites cavités de la roche
dans la zone phréatique marine. En tant que tels, ces derniers peuvent pousser de manière
centripète dans toutes les directions (et pas seulement vers le bas). Résumé : Après à un bref rappel de quelques principes
fondamentaux de la sédimentologie (pétrographie sédimentaire) des carbonates
qui met en évidence l'importance de la matière organique, quelques
exemples de biocristaux dans les grains calcaires, tels que les bioclastes ou
les ooïdes, sont présentés dans un chapitre d'introduction à une discussion
portant sur la distinction entre ciments gravitationnels et endostromatolithes.
Les ciments gravitationnels, qu'ils soient marins (fibreux) ou continentaux (en "dents de chien"), sont constitués de cristaux sparitiques
hyalins (c'est-à-dire translucides) tandis que les endostromatolithes sont
constitués de cristaux sparitiques colorés et /ou de micrite. Les
ciments gravitationnels se forment dans la zone vadose alors que les
endostromatolithes poussent probablement dans de petites cavités de la roche
dans la zone phréatique marine. En tant que tels, ces derniers peuvent pousser de manière
centripète dans toutes les directions (et pas seulement vers le bas).
|
|
Carnets Geol., vol. 20, nº 20, p. 407-419
En ligne depuis le 20 novembre 2020
|
|
Adelocoenia (Stylinidae), genre scléractiniaire mésozoïque, et ses espèces jurassiques
Bernard LATHUILIÈRE, Rosemarie C. BARON-SZABO, Sylvain CHARBONNIER & Jean-Michel PACAUD
| HTML  | PDF
| PDF  [4.677 KB]
| DOI : 10.2110/carnets.2020.2019 [4.677 KB]
| DOI : 10.2110/carnets.2020.2019
|
|
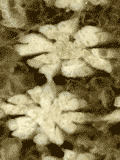 Résumé : Le genre Adelocoenia Orbigny,
1849, est révisé et un néotype est désigné pour son espèce type Astrea
castellum Michelin, 1844. Pour diverses raisons qui tiennent à
l'histoire taxinomique des coraux scléractiniaires, il est devenu difficile
d'identifier de manière fiable des coraux mésozoïques combinant les caractéristiques
d'une structure coloniale plocoïde et une absence de columelle. C'est
pourquoi de tels genres ont besoin d'être révisés, et parmi eux, Adelocoenia.
En complément à la révision de l'espèce type, les espèces jurassiques
regroupées au sein d'Adelocoenia sont
révisées en utilisant le matériel type lorsque cela était possible. De
nombreuses nouvelles synonymies sont proposées, fondées principalement sur des
caractères tels que la symétrie et les dimensions squelettiques. Une autre
conséquence est que la plupart des espèces précédemment groupées au sein de
Pseudocoenia Orbigny sont transférées
vers Adelocoenia. En outre, nous présentons
une vue clarifiée des distributions paléogéographiques et stratigraphiques du
genre Adelocoenia, selon laquelle ce
genre a fait sa première apparition au cours du Jurassique inférieur, représenté
par un seul spécimen connu du Sinémurien de France. Par la suite, ce genre a
connu une augmentation significative de sa répartition et de sa diversité au
cours du Dogger. L'apogée de son succès a suivi au Jurassique supérieur au
cours duquel Adelocoenia a montré ses
plus grandes disparité morphologique et diversité taxinomique, ainsi que son
aire de répartition la plus vaste. Le genre a survécu dans l'enregistrement
fossile du Crétacé. Tout au long de son histoire, Adelocoenia
a principalement vécu dans des environnements de plates-formes internes de
basses latitudes. Résumé : Le genre Adelocoenia Orbigny,
1849, est révisé et un néotype est désigné pour son espèce type Astrea
castellum Michelin, 1844. Pour diverses raisons qui tiennent à
l'histoire taxinomique des coraux scléractiniaires, il est devenu difficile
d'identifier de manière fiable des coraux mésozoïques combinant les caractéristiques
d'une structure coloniale plocoïde et une absence de columelle. C'est
pourquoi de tels genres ont besoin d'être révisés, et parmi eux, Adelocoenia.
En complément à la révision de l'espèce type, les espèces jurassiques
regroupées au sein d'Adelocoenia sont
révisées en utilisant le matériel type lorsque cela était possible. De
nombreuses nouvelles synonymies sont proposées, fondées principalement sur des
caractères tels que la symétrie et les dimensions squelettiques. Une autre
conséquence est que la plupart des espèces précédemment groupées au sein de
Pseudocoenia Orbigny sont transférées
vers Adelocoenia. En outre, nous présentons
une vue clarifiée des distributions paléogéographiques et stratigraphiques du
genre Adelocoenia, selon laquelle ce
genre a fait sa première apparition au cours du Jurassique inférieur, représenté
par un seul spécimen connu du Sinémurien de France. Par la suite, ce genre a
connu une augmentation significative de sa répartition et de sa diversité au
cours du Dogger. L'apogée de son succès a suivi au Jurassique supérieur au
cours duquel Adelocoenia a montré ses
plus grandes disparité morphologique et diversité taxinomique, ainsi que son
aire de répartition la plus vaste. Le genre a survécu dans l'enregistrement
fossile du Crétacé. Tout au long de son histoire, Adelocoenia
a principalement vécu dans des environnements de plates-formes internes de
basses latitudes.
|
|
Carnets Geol., vol. 20, nº 19, p. 367-406
En ligne depuis le 11 novembre 2020
|
|
Les rudistes (Bivalvia) silicifiés et exceptionnellement bien conservés du Maastrichtien inférieur de Porto Rico
Simon F. MITCHELL
| HTML  | PDF
| PDF  [5.339 KB]
| DOI : 10.2110/carnets.2020.2018 [5.339 KB]
| DOI : 10.2110/carnets.2020.2018
|
|
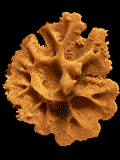 Résumé : Des rudistes hippuritidés exceptionnellement bien
conservés (silicifiés) sont observés dans la Formation d'El Rayo (Maastrichtien
inférieur) du sud-ouest de Porto Rico. Trois espèces appartenant à trois genres différents sont
représentées : Caribbea
muellerreidi (Vermunt), Laluzia
peruviana (Gerth) et Parastroma
guitarti (Palmer). La dissolution par de l'acide des
matrices calcaires a fourni
une collection de nombreuses valves senestres et dextres en trois dimensions,
dont de nombreuses présentant les menus détails du système de
pores. Les caractéristiques morphologiques de chaque espèce sont décrites, et
nombre de ces traits sont illustrés pour la première fois. Ce nouveau matériel,
associé aux descriptions présentes dans d'autres études, montre que six genres
d'hippuritidés endémiques ont évolué en deux radiations distinctes dans le
Nouveau Monde : une radiation plus ancienne avec des formes qui comportent des canaux
palléaux dans la valve senestre (Barrettia, Whitfieldiella
et Parastroma) et
une radiation plus récente de formes dépourvues de canaux palléaux dans cette
même valve senestre (Laluzia, Caribbea and Praebarrettia). La délicate conservation
montre également que, chez ces hippuritidés endémiques du Nouveau Monde, les
alvéoles pour les dents consistaient en des fentes dans lesquelles les côtes des
dents s'ajustaient ; cela contraste avec les hippuritidés de l'Ancien Monde qui
présentent de véritables alvéoles constituées par les replis des tabulae
pour les dents. La morphologie unique de ces alvéoles dentaires est utilisée
ici pour définir une sous-famille monophylétique pour laquelle le nom de
Barrettiinae Chubb
est disponible. Résumé : Des rudistes hippuritidés exceptionnellement bien
conservés (silicifiés) sont observés dans la Formation d'El Rayo (Maastrichtien
inférieur) du sud-ouest de Porto Rico. Trois espèces appartenant à trois genres différents sont
représentées : Caribbea
muellerreidi (Vermunt), Laluzia
peruviana (Gerth) et Parastroma
guitarti (Palmer). La dissolution par de l'acide des
matrices calcaires a fourni
une collection de nombreuses valves senestres et dextres en trois dimensions,
dont de nombreuses présentant les menus détails du système de
pores. Les caractéristiques morphologiques de chaque espèce sont décrites, et
nombre de ces traits sont illustrés pour la première fois. Ce nouveau matériel,
associé aux descriptions présentes dans d'autres études, montre que six genres
d'hippuritidés endémiques ont évolué en deux radiations distinctes dans le
Nouveau Monde : une radiation plus ancienne avec des formes qui comportent des canaux
palléaux dans la valve senestre (Barrettia, Whitfieldiella
et Parastroma) et
une radiation plus récente de formes dépourvues de canaux palléaux dans cette
même valve senestre (Laluzia, Caribbea and Praebarrettia). La délicate conservation
montre également que, chez ces hippuritidés endémiques du Nouveau Monde, les
alvéoles pour les dents consistaient en des fentes dans lesquelles les côtes des
dents s'ajustaient ; cela contraste avec les hippuritidés de l'Ancien Monde qui
présentent de véritables alvéoles constituées par les replis des tabulae
pour les dents. La morphologie unique de ces alvéoles dentaires est utilisée
ici pour définir une sous-famille monophylétique pour laquelle le nom de
Barrettiinae Chubb
est disponible.
|
|
Carnets Geol., vol. 20, nº 18, p. 333-366
En ligne depuis le 11 novembre 2020
|
|
Ostracodes du Lago-Mare messinien en Tunisie
Rim TEMANI, Francesco SCIUTO & Hayet K. AMMAR
| HTML  | PDF
| PDF  [1.121 KB]
| DOI : 10.2110/carnets.2020.2017 [1.121 KB]
| DOI : 10.2110/carnets.2020.2017
|
|
 Résumé : Des
analyses micropaléontologiques ont été réalisées sur deux coupes stratigraphiques échantillonnées
dans des dépôts du Messinien supérieur affleurant en Tunisie orientale. Elles nous
ont permis d'identifier certains niveaux sédimentaires présentant de fortes concentrations
en ostracodes d'eaux douce ou saumâtre, qui peuvent être rapportés à la faune de faciès Lago-Mare.
Certaines de ces espèces peuvent être considérées comme paratéthysiennes ou
plutôt comme des espèces ayant migré en Mer Méditerranéenne depuis les régions
paratéthysiennes,
alors que d'autres présentent une affinité paratéthysienne. La faune de faciès Lago-Mare est peu connue
dans les régions sud-méditerranéennes et cet article
fournit de nouvelles données sur sa répartition géographique. Résumé : Des
analyses micropaléontologiques ont été réalisées sur deux coupes stratigraphiques échantillonnées
dans des dépôts du Messinien supérieur affleurant en Tunisie orientale. Elles nous
ont permis d'identifier certains niveaux sédimentaires présentant de fortes concentrations
en ostracodes d'eaux douce ou saumâtre, qui peuvent être rapportés à la faune de faciès Lago-Mare.
Certaines de ces espèces peuvent être considérées comme paratéthysiennes ou
plutôt comme des espèces ayant migré en Mer Méditerranéenne depuis les régions
paratéthysiennes,
alors que d'autres présentent une affinité paratéthysienne. La faune de faciès Lago-Mare est peu connue
dans les régions sud-méditerranéennes et cet article
fournit de nouvelles données sur sa répartition géographique.
Des deux sections étudiées, la première, la coupe de Wadi El Kebir, située dans
la partie sud-est de la péninsule du Cap Bon, comporte des niveaux dominés
par Cyprideis agrigentina et Cyprideis
ex gr. C. torosa, tandis que la seconde, la coupe de Salakta, située dans
la région du Sahel, comporte un niveau doté d'une très riche faune d'ostracodes de faciès Lago-Mare,
essentiellement constituée des espèces Amnicythere
propinqua, Mediocytherideis punctata
et Ilyocypris gibba.
|
|
Carnets Geol., vol. 20, nº 17, p. 315-331
En ligne depuis le 14 octobre 2020
|
|
Première découverte attestée de la tortue d'eau douce Mauremys
dans le Pliocène supérieur d'Italie, avec un nouveau signalement de Thatchtelithichnus holmani, un ichnotaxon rarement mentionné
Alberto COLLARETA, Simone CASATI, Marco A.L. ZUFFI & Andrea DI CENCIO
| HTML  | PDF
| PDF  [1.078 KB]
| DOI : 10.2110/carnets.2020.2016 [1.078 KB]
| DOI : 10.2110/carnets.2020.2016
|
|
 Résumé : De nos jours, les espèces du genre de tortues d'eau douce Mauremys (Testudinoidea : Geoemydidae)
vivent principalement en Asie orientale, mais trois d'entre elles habitent
l'écozone paléarctique occidentale. En Italie, les découvertes d'individus vivants de Mauremys
sont interprétées comme des signalements d'espèces étrangères ; cependant,
un nombre croissant de fossiles montre que ce genre était présent en Italie dès le Pléistocène
supérieur. Nous signalons un nouveau spécimen fossile de
Mauremys provenant de dépôts marginaux marins du Pliocène supérieur (Plaisancien) de Toscane (Italie
centrale). Cette découverte, comprenant un plastron partiel et une neurale
désarticulée, représente le second signalement confirmé de Mauremys
dans le Pliocène italien et le premier dans le Plaisancien d'Italie. Ainsi,
ce spécimen représente un fossile significatif puisque, avec l'holotype zancléen de Mauremys portisi,
il comble la lacune entre les segments miocène et pléistocène dans la
distribution chronostratigraphique des fossiles italiens de Mauremys. En outre, deux
cicatrices insolites observées sur la surface externe du plastron étudié sont
attribuées ici à l'ichno-espèce Thatchtelithichnus holmani. Il s'agit d'un des rares signalements de
cette ichno-espèce à l'échelle planétaire et aussi de son occurrence stratigraphique la plus jeune.
Les hypothèses concernant l'origine des traces de type Thatchtelithichnus
sont reconsidérées à la lumière de notre découverte et leur
interprétation en tant que traces cicatricielles d'attachement d'ectoparasites aquatiques (probablement des
tiques, des sangsues ou des douves) est réaffirmée comme probable dans le cas de traces
situées sur la face externe des plaques plastrales des tortues. Résumé : De nos jours, les espèces du genre de tortues d'eau douce Mauremys (Testudinoidea : Geoemydidae)
vivent principalement en Asie orientale, mais trois d'entre elles habitent
l'écozone paléarctique occidentale. En Italie, les découvertes d'individus vivants de Mauremys
sont interprétées comme des signalements d'espèces étrangères ; cependant,
un nombre croissant de fossiles montre que ce genre était présent en Italie dès le Pléistocène
supérieur. Nous signalons un nouveau spécimen fossile de
Mauremys provenant de dépôts marginaux marins du Pliocène supérieur (Plaisancien) de Toscane (Italie
centrale). Cette découverte, comprenant un plastron partiel et une neurale
désarticulée, représente le second signalement confirmé de Mauremys
dans le Pliocène italien et le premier dans le Plaisancien d'Italie. Ainsi,
ce spécimen représente un fossile significatif puisque, avec l'holotype zancléen de Mauremys portisi,
il comble la lacune entre les segments miocène et pléistocène dans la
distribution chronostratigraphique des fossiles italiens de Mauremys. En outre, deux
cicatrices insolites observées sur la surface externe du plastron étudié sont
attribuées ici à l'ichno-espèce Thatchtelithichnus holmani. Il s'agit d'un des rares signalements de
cette ichno-espèce à l'échelle planétaire et aussi de son occurrence stratigraphique la plus jeune.
Les hypothèses concernant l'origine des traces de type Thatchtelithichnus
sont reconsidérées à la lumière de notre découverte et leur
interprétation en tant que traces cicatricielles d'attachement d'ectoparasites aquatiques (probablement des
tiques, des sangsues ou des douves) est réaffirmée comme probable dans le cas de traces
situées sur la face externe des plaques plastrales des tortues.
|
|
Carnets Geol., vol. 20, nº 16, p. 301-313
En ligne depuis le 14 octobre 2020
|
|
Données complémentaires sur les lys de mer post-paléozoïques
(crinoïdes ; Crinoidea, Echinodermata) des Carpathes externes de la République tchèque et de Pologne
Mariusz A. SALAMON, Miroslav BUBÍK, Bruno FERRÉ, Andrzej SZYDŁO, Piotr NESCIERUK, Bartosz J. PŁACHNO, Tomasz BRACHANIEC & Karolina PASZCZA
| HTML  | PDF
| PDF  [1.067 KB]
| DOI : 10.2110/carnets.2020.2015 [1.067 KB]
| DOI : 10.2110/carnets.2020.2015
|
|
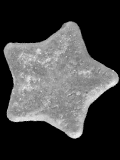 Résumé : Les dépôts jurassiques
(Tithonien) et crétacés inférieurs
(Berriasien/Valanginien-Hauterivien) des formations de Vendryně et des
Calcaires de Cieszyn de la République tchèque et de Pologne sont localement
riches en restes crinoïdiques, représentés par des thèques entières, éléments
isolés de thèque, pièces brachiales, columnales et pluri-columnales, de
cirres et de crampons. Ils sont rapportés respectivement aux isocrinides (Isocrinida :
Isocrinus cf. amblyscalaris,
Isocrinida indet.), cyrtocrinides (Cyrtocrinida : Eugeniacrinites sp.,
Phyllocrinus sp., Gammarocrinites sp.,
Hemicrinus tithonicus, Plicatocrinus
hexagonus, Cyrtocrinida indet.), millericrinides (Millericrinida :
Millericrinida indet.) et aux thiolliericrinides (Comatulida, Thiolliericrinidae :
Thiolliericrinidae gen. et sp. indet.). Ces crinoïdes du Crétacé supérieur (Maastrichtien)
et du Paléogène (Paléocène-Oligocène) sont représentés par des restes
isolés appartenant aux : Isocrinida indet., Cyrtocrinida indet.,
bourgueticrinides (Comatulida, Bourgueticrinina : Bourgueticrinina fam. et
gen. indet.) et aux rovéacrinides (Roveacrinida, Roveacrinidae gen. et sp.
indet.). Les rovéacrinides ont été récupérés uniquement dans les échantillons
du Maastrichtien. Malgré les conclusions présentées préalablement que les
isocrinides des Carpathes du Flysch externe dominaient aux alentours de la
limite Jurassique-Crétacé en raison de l'environnement sédimentaire
beaucoup moins profond de ces dépôts, nous pouvons maintenant conclure
qu'ils furent communs et associés aux cyrtocrinides dans tous les types
d'environnement. Il est également utile de préciser que les cyrtocrinides et
les isocrinides sont présents dans les sediments paléogènes qui furent déposés
dans les environnements extrêmement peu profonds. De nombreuses données suggèrent
que les isocrinides crétacés (depuis le Crétacé moyen) ont migré dans les
zones d'eaux profondes en réponse à l'accroisssement du nombre de prédateurs
lors de la soi-disant révolution marine mésozoïque. Résumé : Les dépôts jurassiques
(Tithonien) et crétacés inférieurs
(Berriasien/Valanginien-Hauterivien) des formations de Vendryně et des
Calcaires de Cieszyn de la République tchèque et de Pologne sont localement
riches en restes crinoïdiques, représentés par des thèques entières, éléments
isolés de thèque, pièces brachiales, columnales et pluri-columnales, de
cirres et de crampons. Ils sont rapportés respectivement aux isocrinides (Isocrinida :
Isocrinus cf. amblyscalaris,
Isocrinida indet.), cyrtocrinides (Cyrtocrinida : Eugeniacrinites sp.,
Phyllocrinus sp., Gammarocrinites sp.,
Hemicrinus tithonicus, Plicatocrinus
hexagonus, Cyrtocrinida indet.), millericrinides (Millericrinida :
Millericrinida indet.) et aux thiolliericrinides (Comatulida, Thiolliericrinidae :
Thiolliericrinidae gen. et sp. indet.). Ces crinoïdes du Crétacé supérieur (Maastrichtien)
et du Paléogène (Paléocène-Oligocène) sont représentés par des restes
isolés appartenant aux : Isocrinida indet., Cyrtocrinida indet.,
bourgueticrinides (Comatulida, Bourgueticrinina : Bourgueticrinina fam. et
gen. indet.) et aux rovéacrinides (Roveacrinida, Roveacrinidae gen. et sp.
indet.). Les rovéacrinides ont été récupérés uniquement dans les échantillons
du Maastrichtien. Malgré les conclusions présentées préalablement que les
isocrinides des Carpathes du Flysch externe dominaient aux alentours de la
limite Jurassique-Crétacé en raison de l'environnement sédimentaire
beaucoup moins profond de ces dépôts, nous pouvons maintenant conclure
qu'ils furent communs et associés aux cyrtocrinides dans tous les types
d'environnement. Il est également utile de préciser que les cyrtocrinides et
les isocrinides sont présents dans les sediments paléogènes qui furent déposés
dans les environnements extrêmement peu profonds. De nombreuses données suggèrent
que les isocrinides crétacés (depuis le Crétacé moyen) ont migré dans les
zones d'eaux profondes en réponse à l'accroisssement du nombre de prédateurs
lors de la soi-disant révolution marine mésozoïque.
|
|
Carnets Geol., vol. 20, nº 15, p. 283-299
En ligne depuis le 14 octobre 2020
|
|
Sélection du lectotype d'Orbitolinopsis flandrini Moullade, 1960 (Foraminifère) : La pièce manquante d'un puzzle taxinomique
Felix SCHLAGINTWEIT, Ioan I. BUCUR & François LE COZE
| HTML  | PDF
| PDF  [1.370 KB]
| DOI : 10.2110/carnets.2020.2014 [1.370 KB]
| DOI : 10.2110/carnets.2020.2014
|
|
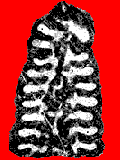 Résumé : Orbitolinopsis flandrini
Moullade, 1960, a été décrit dans les calcaires urgoniens
(Crétacé inférieur) du sud-est de la France. La validité de ce taxon n'est pas en
question, la désignation d'un holotype n'étant obligatoire que pour les
taxons décrits après 1989 (CINZ, 4e édition, article 72.3).
Aujourd'hui, la
description originale de cette espèce est considérée comme fondée sur un mélange de taxons rapportés aux genres Orbitolinopsis
Henson, 1948, Cribellopsis Arnaud-Vanneau,
1980 (sections transversales à cupules/septules dans la partie centrale) et Drevennia
Arnaud-Vanneau, 1980 (sections axiales avec une colonne axiale
"semblable
à une columelle"). Toutefois cette description originale, courte et donc
insuffisante, soulignait la
présence d'une partie centrale du test semblable à une "columelle"
comme étant la caractéristique distinctive de l'espèce. De fait, la majorité
des sections (sub-) axiales montrant une colonne axiale (absente chez les Orbitolinopsis)
sont considérées comme appartenant au genre Drevennia
(Famille des Pfenderinidae). Par conséquent, la nouvelle combinaison Drevennia
flandrini (Moullade, 1960) est proposée et un lectotype est
sélectionné à partir des illustrations originales. Drevennia
ecougensis, l'espèce-type du genre, est mise en synonymie avec D. flandrini,
cette dernière
espèce ayant priorité sur D.
ecougensis (synonyme subjectif plus ancien). De nouvelles découvertes en
Serbie permettent d'élargir la répartition stratigraphique de D. flandrini du Berriasien supérieur à l'Aptien
inférieur. Les
premières apparitions de Drevennia, Dobrogelina
Neagu, 1979, Pfenderina Henson,
1948, et Moulladella Bucur
& Schlagintweit, 2018, au Berriasien supérieur apportent la preuve
d'une radiation adaptative des Pfenderinidae à cette époque, phénomène déjà
noté pour d'autres types de foraminifères benthiques principalement chez les grands
foraminifères complexes (e.g., Orbitolinidae). Résumé : Orbitolinopsis flandrini
Moullade, 1960, a été décrit dans les calcaires urgoniens
(Crétacé inférieur) du sud-est de la France. La validité de ce taxon n'est pas en
question, la désignation d'un holotype n'étant obligatoire que pour les
taxons décrits après 1989 (CINZ, 4e édition, article 72.3).
Aujourd'hui, la
description originale de cette espèce est considérée comme fondée sur un mélange de taxons rapportés aux genres Orbitolinopsis
Henson, 1948, Cribellopsis Arnaud-Vanneau,
1980 (sections transversales à cupules/septules dans la partie centrale) et Drevennia
Arnaud-Vanneau, 1980 (sections axiales avec une colonne axiale
"semblable
à une columelle"). Toutefois cette description originale, courte et donc
insuffisante, soulignait la
présence d'une partie centrale du test semblable à une "columelle"
comme étant la caractéristique distinctive de l'espèce. De fait, la majorité
des sections (sub-) axiales montrant une colonne axiale (absente chez les Orbitolinopsis)
sont considérées comme appartenant au genre Drevennia
(Famille des Pfenderinidae). Par conséquent, la nouvelle combinaison Drevennia
flandrini (Moullade, 1960) est proposée et un lectotype est
sélectionné à partir des illustrations originales. Drevennia
ecougensis, l'espèce-type du genre, est mise en synonymie avec D. flandrini,
cette dernière
espèce ayant priorité sur D.
ecougensis (synonyme subjectif plus ancien). De nouvelles découvertes en
Serbie permettent d'élargir la répartition stratigraphique de D. flandrini du Berriasien supérieur à l'Aptien
inférieur. Les
premières apparitions de Drevennia, Dobrogelina
Neagu, 1979, Pfenderina Henson,
1948, et Moulladella Bucur
& Schlagintweit, 2018, au Berriasien supérieur apportent la preuve
d'une radiation adaptative des Pfenderinidae à cette époque, phénomène déjà
noté pour d'autres types de foraminifères benthiques principalement chez les grands
foraminifères complexes (e.g., Orbitolinidae).
|
|
Carnets Geol., vol. 20, nº 14, p. 273-282
En ligne depuis le 21 septembre 2020
|
|
Considérations stratigraphiques et taxonomiques sur la faune de rudistes du Crétacé supérieur d'Aksai Chin (Tibet occidental, Chine) appartenant à la Collection De Filippi
Jingeng SHA, Simone FABBI, Riccardo CESTARI & Lorenzo CONSORTI
| HTML  | PDF
| PDF  [3.300 KB]
| DOI : 10.2110/carnets.2020.2013 [3.300 KB]
| DOI : 10.2110/carnets.2020.2013
|
|
 Résumé : La faune de rudistes récoltée dans la région
d'Aksai Chin dans l'ouest du Tibet par l'expédition De Filippi en 1914
est réexaminée et redécrite. Cette faune est composée de Radiolites cf. lusitanicus, Radiolites sp., Gorjanovicia cf. endrissi,
? Sauvagesia sp., Sphaerulites sp., Durania sp. et Gyropleura sp. Les
couches à rudistes appartiennent au Groupe Tielongtan du terrane de Tianshuihai.
La Formation Xiloqzung du Turonien - ? Coniacien recèle les rudistes les plus
anciens (Radiolites cf. lusitanicus, Radiolites sp., Sphaerulites sp., Durania
sp.), tandis que l'analyse du contenu microfossilifère par comparaison avec
celui de la Néotéthys occidentale suggère un âge Campanien inférieur à
moyen pour les rudistes les plus jeunes. Ceci permet
d'attribuer les rudistes les plus jeunes appartenant à la collection (Gorjanovicia cf. endrissi,
? Sauvagesia sp., Gyropleura sp. et Radiolites sp.) à la Formation de Dongloqzung. Nos données confirment que les faciès
à rudistes du Groupe Tielongtan sont présents au moins jusqu'au Campanien moyen.
L'association de rudistes de l'Aksai Chin devrait être rattachée à l'association
du sud-ouest asiatique au sein de la Sous-Province méditerranéenne orientale. Résumé : La faune de rudistes récoltée dans la région
d'Aksai Chin dans l'ouest du Tibet par l'expédition De Filippi en 1914
est réexaminée et redécrite. Cette faune est composée de Radiolites cf. lusitanicus, Radiolites sp., Gorjanovicia cf. endrissi,
? Sauvagesia sp., Sphaerulites sp., Durania sp. et Gyropleura sp. Les
couches à rudistes appartiennent au Groupe Tielongtan du terrane de Tianshuihai.
La Formation Xiloqzung du Turonien - ? Coniacien recèle les rudistes les plus
anciens (Radiolites cf. lusitanicus, Radiolites sp., Sphaerulites sp., Durania
sp.), tandis que l'analyse du contenu microfossilifère par comparaison avec
celui de la Néotéthys occidentale suggère un âge Campanien inférieur à
moyen pour les rudistes les plus jeunes. Ceci permet
d'attribuer les rudistes les plus jeunes appartenant à la collection (Gorjanovicia cf. endrissi,
? Sauvagesia sp., Gyropleura sp. et Radiolites sp.) à la Formation de Dongloqzung. Nos données confirment que les faciès
à rudistes du Groupe Tielongtan sont présents au moins jusqu'au Campanien moyen.
L'association de rudistes de l'Aksai Chin devrait être rattachée à l'association
du sud-ouest asiatique au sein de la Sous-Province méditerranéenne orientale.
|
|
Carnets Geol., vol. 20, nº 13, p. 249-272
En ligne depuis le 21 septembre 2020
|
|
Découverte de moldavite dans des sédiments du Miocène moyen (Langhien) du sud-ouest de la Pologne
Tomasz BRACHANIEC
| HTML  | PDF
| PDF  [510 KB]
| DOI : 10.2110/carnets.2020.2012 [510 KB]
| DOI : 10.2110/carnets.2020.2012
|
|
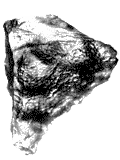 Résumé : La plupart des tectites de Ries
(moldavites) se sont déposées dans des
sédiments clairement postérieurs à la formation du cratère de Ries, ce qui
suggère un dépôt secondaire de ces éjectas vitreux. Seules quelques
formations sédimentaires connues pour livrer ces tectites sont d'âge miocène
moyen et contemporaines de l'événement de Ries. L'une d'elle, la
Formation Poznańska, affleure à travers la Pologne sud-occidentale. Ses
dépôts argileux se sont formés au Miocène moyen (Langhien). Les nouvelles
moldavites décrites dans cette note proviennent de la Formation Poznańska.
Elles pèsent de 0,851 à 0,907 g. La sablière de Stanisław
Nord, où ont été trouvées ces tectites, est située à 490 km de
la structure de Ries. Ces découvertes s'accordent parfaitement avec les simulations numériques modélisant
l'éjection de ces moldavites à plus de 600 km du cratère source. Résumé : La plupart des tectites de Ries
(moldavites) se sont déposées dans des
sédiments clairement postérieurs à la formation du cratère de Ries, ce qui
suggère un dépôt secondaire de ces éjectas vitreux. Seules quelques
formations sédimentaires connues pour livrer ces tectites sont d'âge miocène
moyen et contemporaines de l'événement de Ries. L'une d'elle, la
Formation Poznańska, affleure à travers la Pologne sud-occidentale. Ses
dépôts argileux se sont formés au Miocène moyen (Langhien). Les nouvelles
moldavites décrites dans cette note proviennent de la Formation Poznańska.
Elles pèsent de 0,851 à 0,907 g. La sablière de Stanisław
Nord, où ont été trouvées ces tectites, est située à 490 km de
la structure de Ries. Ces découvertes s'accordent parfaitement avec les simulations numériques modélisant
l'éjection de ces moldavites à plus de 600 km du cratère source.
|
|
Carnets Geol., vol. 20, nº 12, p. 241-247
En ligne depuis le 30 juin 2020
|
|
Chamberlainium pentagonum (Conti) n.comb. et Spongites fruticulosus (Corallinales, Rhodophyta) dans les calcaires miocènes de Méditerranée occidentale
Giovanni COLETTI, Juraj HRABOVSKÝ & Daniela BASSO
| HTML  | PDF
| PDF  [1.526 KB]
| DOI : 10.4267/2042/70837 [1.526 KB]
| DOI : 10.4267/2042/70837
|
|
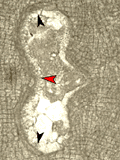 Résumé : Des analyses phylogénétiques moléculaires ont révélé une biodiversité inattendue au sein des algues rouges
calcaires des océans modernes. Il est peu probable que cette richesse
des espèces soit une caractéristique exclusive des écosystèmes modernes. Afin d'étudier la biodiversité des algues rouges
calcaires fossiles, un large ensemble de données issues d'échantillons du Miocène de la Méditerranée occidentale, auparavant identifiés comme Spongites fruticulosus (et ses synonymes juniors), a été révisé en s'appuyant sur le cadre taxinomique
moderne. Cette analyse a identifié deux groupes distincts. Le premier groupe comporte les spécimens correspondant à la description actuelle de S. fruticulosus. Le second groupe est constitué par Chamberlainium pentagonum n.comb., premier fossile représentatif du genre. Cette espèce a été
séparée de Spongites fruticulosus sur la base de la plus petite taille de ses conceptables et de l'épaisseur moindre du toit de ces derniers. Les mêmes caractéristiques ont été mises en
évidence par les analyses phylogénétiques moléculaires modernes permettant
de séparer Chamberlainium de Spongites. Chamberlainium pentagonum, tout comme les spécimens fossiles de
Spongites fruticulosus, est présent dans la majeure partie de la zone étudiée et ces deux espèces cohabitent dans plusieurs localités, indiquant une tolérance écologique
large et similaire pour les deux taxons. Ces résultats suggèrent que la biodiversité des algues rouges
calcaires miocènes est probablement sous-estimée ; ils montrent l'intérêt d'utiliser des
ensembles de données conséquents pour étudier les algues rouges calcaires fossiles. Résumé : Des analyses phylogénétiques moléculaires ont révélé une biodiversité inattendue au sein des algues rouges
calcaires des océans modernes. Il est peu probable que cette richesse
des espèces soit une caractéristique exclusive des écosystèmes modernes. Afin d'étudier la biodiversité des algues rouges
calcaires fossiles, un large ensemble de données issues d'échantillons du Miocène de la Méditerranée occidentale, auparavant identifiés comme Spongites fruticulosus (et ses synonymes juniors), a été révisé en s'appuyant sur le cadre taxinomique
moderne. Cette analyse a identifié deux groupes distincts. Le premier groupe comporte les spécimens correspondant à la description actuelle de S. fruticulosus. Le second groupe est constitué par Chamberlainium pentagonum n.comb., premier fossile représentatif du genre. Cette espèce a été
séparée de Spongites fruticulosus sur la base de la plus petite taille de ses conceptables et de l'épaisseur moindre du toit de ces derniers. Les mêmes caractéristiques ont été mises en
évidence par les analyses phylogénétiques moléculaires modernes permettant
de séparer Chamberlainium de Spongites. Chamberlainium pentagonum, tout comme les spécimens fossiles de
Spongites fruticulosus, est présent dans la majeure partie de la zone étudiée et ces deux espèces cohabitent dans plusieurs localités, indiquant une tolérance écologique
large et similaire pour les deux taxons. Ces résultats suggèrent que la biodiversité des algues rouges
calcaires miocènes est probablement sous-estimée ; ils montrent l'intérêt d'utiliser des
ensembles de données conséquents pour étudier les algues rouges calcaires fossiles.
|
|
Carnets Geol., vol. 20, nº 11, p. 223-240
En ligne depuis le 30 mai 2020
|
|
Première occurrence du Vetulicolia problématique Skeemella clavula dans la Formation cambrienne de Marjum Formation d'Utah, É.U.A.
Julien KIMMIG, Wade W. LEIBACH & Bruce S. LIEBERMAN
| HTML  | PDF
| PDF  [798 KB]
| DOI : 10.4267/2042/70836 [798 KB]
| DOI : 10.4267/2042/70836
|
|
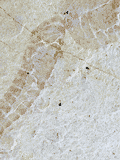 Résumé : Dans l'ouest
de l'Utah (É.U.A.), la Formation cambrienne de Marjum préserve une faune diversifiée
d'animaux à corps mou dans le Drumien supérieur, une faune légèrement plus jeune que celle des fameux Schistes de
Burgess. Alors que la Formation de Marjum est dominée par les arthropodes, des
animaux appartenant à différents phylums ont également été découverts.
Nous illustrons ici la seconde occurrence de Skeemella
clavula, un rare et énigmatique taxon dont on pensait précédemment qu'il
n'était présent que dans la Formation de Pierson
Cove des Montagnes de Drum (N Utah). Leur présence dans la Formation de Marjum représente un
nouveau milieu de conservation, ainsi qu'un dépôt légèrement plus jeune. Les
nouveaux spécimens portent à trois le nombre de spécimens connus. Enfin, ces
spécimens contribuent à une meilleure compréhension de la morphologie
de ce représentant du phylum problématique des Vetulicolia. Résumé : Dans l'ouest
de l'Utah (É.U.A.), la Formation cambrienne de Marjum préserve une faune diversifiée
d'animaux à corps mou dans le Drumien supérieur, une faune légèrement plus jeune que celle des fameux Schistes de
Burgess. Alors que la Formation de Marjum est dominée par les arthropodes, des
animaux appartenant à différents phylums ont également été découverts.
Nous illustrons ici la seconde occurrence de Skeemella
clavula, un rare et énigmatique taxon dont on pensait précédemment qu'il
n'était présent que dans la Formation de Pierson
Cove des Montagnes de Drum (N Utah). Leur présence dans la Formation de Marjum représente un
nouveau milieu de conservation, ainsi qu'un dépôt légèrement plus jeune. Les
nouveaux spécimens portent à trois le nombre de spécimens connus. Enfin, ces
spécimens contribuent à une meilleure compréhension de la morphologie
de ce représentant du phylum problématique des Vetulicolia.
|
|
Carnets Geol., vol. 20, nº 10, p. 215-221
En ligne depuis le 30 mai 2020
|
|
Metacuvillierinella sireli n. sp., un nouveau Rhapydioninidae (Foraminifères) du sud-ouest de la Turquie, occasion de nouvelles observations sur l'endosquelette et les particularités de la famille, avec un lexique spécialisé
Jean-Jacques FLEURY & Recep ÖZKAN
| HTML  | PDF
| PDF  [4.532 KB]
| DOI : 10.4267/2042/70793 [4.532 KB]
| DOI : 10.4267/2042/70793
|
|
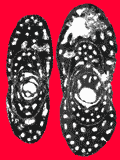 Résumé : La famille des
Rhapydioninidae est une partie de la superfamille des Alveolinacea. La
principale caractéristique de cette superfamille est constituée par son
endosquelette, divisant chaque loge en logettes tubulaires ordinairement
orientées parallèlement à la direction d'enroulement, ne communicant que
dans un espace indivis situé dans la partie antérieure des loges :
L'espace préseptal. Les Rhapydioninidae sont en partie particularisés par
la compression du test dans le plan équatorial et par leur tendance au déroulement
final, contrairement aux Alveolinidae, la famille sœur, qui sont allongés
axialement et ne se déroulent jamais. Les Rhapydioninidae sont en outre
distingués par la coexistence de deux types de logettes : Les logettes
primaires, séparées par les cloisonnettes, formant une unique couche dans la
partie périphérique des loges, et les logettes secondaires constituées par
deux ensembles : Les "Logettes Secondaires Basales" (BSC)
formant une couche accolée au tour précédent et les "Logettes
Secondaires Dispersées" (SSC) percées dans une masse plus ou moins compacte,
l' "endosquelette central" (nullement homologue de la "couche
basale", parfois nommée flosculinisation ou columelle, de certains
Alveolinidae). La présence de piliers préseptaux joignant l'endosquelette
central au septe au travers de l'espace préseptal ainsi que les deux modes
particuliers d'organisation des logettes secondaires : Structure des "BSC-SSC" (et sa variante
"filet de pêche") et "structure confluente"
constituent encore des traits distinctifs de la famille ; ils sont analysés
ci-dessous. Résumé : La famille des
Rhapydioninidae est une partie de la superfamille des Alveolinacea. La
principale caractéristique de cette superfamille est constituée par son
endosquelette, divisant chaque loge en logettes tubulaires ordinairement
orientées parallèlement à la direction d'enroulement, ne communicant que
dans un espace indivis situé dans la partie antérieure des loges :
L'espace préseptal. Les Rhapydioninidae sont en partie particularisés par
la compression du test dans le plan équatorial et par leur tendance au déroulement
final, contrairement aux Alveolinidae, la famille sœur, qui sont allongés
axialement et ne se déroulent jamais. Les Rhapydioninidae sont en outre
distingués par la coexistence de deux types de logettes : Les logettes
primaires, séparées par les cloisonnettes, formant une unique couche dans la
partie périphérique des loges, et les logettes secondaires constituées par
deux ensembles : Les "Logettes Secondaires Basales" (BSC)
formant une couche accolée au tour précédent et les "Logettes
Secondaires Dispersées" (SSC) percées dans une masse plus ou moins compacte,
l' "endosquelette central" (nullement homologue de la "couche
basale", parfois nommée flosculinisation ou columelle, de certains
Alveolinidae). La présence de piliers préseptaux joignant l'endosquelette
central au septe au travers de l'espace préseptal ainsi que les deux modes
particuliers d'organisation des logettes secondaires : Structure des "BSC-SSC" (et sa variante
"filet de pêche") et "structure confluente"
constituent encore des traits distinctifs de la famille ; ils sont analysés
ci-dessous.
Une nouvelle espèce campanienne, Metacuvillierinella sireli n. sp., est
décrite, en provenance des
calcaires de la formation Sanli, l'unité terminale supposée du groupe
Adiyaman connu dans la région de Mardin, en Turquie (Anatolie sud-orientale).
Le nouveau taxon est un Rhapydioninidae typique par l'architecture de son
test et son endosquelette. C'est une évidente nouvelle espèce par son
enroulement initial planispiralé des tests A, ses deux générations
pseudoplanispiralées à stade final advolute et ses fines logettes trahissant
un endosquelette de type "BSC-SSC". Son attribution générique est plus
douteuse : Le faible dimorphisme de générations et l'enroulement
advolute des tests ne sont connus que chez le genre Metacuvillierinella, alors
que l'organisation de l'endosquelette, non observée chez le type de ce
genre (M. decastroi), rappelle
certains taxons où cette structure est bien identifiée, tels que Pseudochubbina et Cuvillierinella
perisalentina. Un inventaire général mené au sein des Rhapydioninidae
montre que cette organisation est largement répandue dans toutes les
sous-familles des deux côtés de l'Atlantique et ne peut être considérée
comme un critère distinctif fondamental au sein du groupe; l'un de ses
attributs, l'existence d'une couche de logettes secondaires basales (BSC)
reste cependant indiscernable, pour des raisons géométriques, chez les
taxons comportant des logettes secondaires de fort diamètre, comme chez M. decastroi en
particulier. Ce critère, dont l'observation ne dépend
que de la taille des logettes, ne permet donc pas de discriminer
fondamentalement le nouveau taxon de M.
decastroi, dont il serait un descendant, bien qu'il s'en différencie
encore par la grande taille relative de son proloculus A et le stade initial
non miliolin des tests de génération A ; ces critères, eux-mêmes
susceptibles d'interprétation, ne paraissent pas suffisants pour une
distinction d'ordre générique, qui ne pourrait se justifier qu'en
fonction du "rayonnement" que pourrait présenter le nouveau
taxon, par sa dissémination propre ou celle sa parenté-descendance.
Accessoirement, à l'occasion de la recherche effectuée
pour la reconnaissance de la structure "BSC-SSC", tous les genres connus de
la famille dans l'Ancien et du Nouveau Monde sont reconsidérés: Pseudochubbina,
Cuvillierinella, Murciella, Sigalveolina, Cyclopseudedomia, Sellialveolina,
Rhapydionina, Fanrhapydionina, Chubbina, Praechubbina, Raadshoovenia,
Neomurciella, Twaraina. Une attention particulière est prêtée au genre
Euro asiatique Pseudedomia, dont le type et, en conséquence, les interprétations
consécutives, apparaissent peu fiables. De nouvelles sections de Subalveolina
dordonica et Fleuryana adriatica sont figurées.
La conclusion porte principalement sur les critères de
distinction des divers niveaux systématiques au sein de la famille. On
n'accorde aucun crédit aux classiques distinctions entre caractères dits "spécifiques" et
"génériques". Un mode de
travail plus pragmatique est proposé, considérant chaque caractère comme dépourvu
de signification par lui-même mais nécessitant d'être compris et interprété
parmi les autres, c'est-à-dire dans la perspective évolutive de
l'ensemble du groupe.
On propose en appendice un lexique adapté aux
Rhapydioninidae et aux concepts plus ou moins directement associés à cette
famille.
|
|
Carnets Geol., vol. 20, nº 9, p. 165-213
En ligne depuis le 11 mai 2020
|
|
Notice nomenclaturale, p. 214
|
|
Incidences de l'Évènement Anoxique Océanique II sur l'évolution des ostracodes des dépôts cénomano-turoniens du bassin du Tinrhert (SE Algérie)
Soumia TCHENAR, Bruno FERRÉ, Mohammed ADACI, Djamila ZAOUI, Madani BENYOUCEF, Mustapha BENSALAH & Touria KENTRI
| HTML  | PDF
| PDF  [1.382 KB]
| DOI : 10.4267/2042/70792 [1.382 KB]
| DOI : 10.4267/2042/70792
|
|
 Résumé : Dans le bassin du Tinrhert, au passage Cénomanien/Turonien, les ostracodes sont
rares dans la plupart des niveaux échantillonnés ; ils ne présentent
aucune variabilité, leur fréquence ne dépassant pas 4% de toute la microfaune.
Leur présence optimale, tant qualitative que quantitative, s'observe à la
base du Turonien inférieur où leurs cortèges sont dominés par les genres Cythereis,
Paracypris et Cytherella. Résumé : Dans le bassin du Tinrhert, au passage Cénomanien/Turonien, les ostracodes sont
rares dans la plupart des niveaux échantillonnés ; ils ne présentent
aucune variabilité, leur fréquence ne dépassant pas 4% de toute la microfaune.
Leur présence optimale, tant qualitative que quantitative, s'observe à la
base du Turonien inférieur où leurs cortèges sont dominés par les genres Cythereis,
Paracypris et Cytherella.
Afin de comprendre ces observations, nous avons mené une étude paléoécologique
sur cinq coupes géologiques et reconstitué l'impact des conditions sédimentologiques
(quartz, gypse et pyrite) et celui des variations eustatiques.
|
|
Carnets Geol., vol. 20, nº 8, p. 145-164
En ligne depuis le 11 mai 2020
|
|
A report on the 12th International Symposium on Fossil Algae (Lucknow, India - September 16-18, 2019)
Daniela BASSO, Arindam CHAKRABORTY & Amit K. GHOSH
| HTML  | PDF
| PDF  [2.175 KB] [2.175 KB]
|
|
Carnets Geol., vol. 20, Meeting Review 1, p. 141-144
En ligne depuis le 11 mai 2020
|
|
Nouvelles occurrences de Modulidae (Mollusca : Gastropoda) dans des gisements européens de l'Éocène, de l'Oligocène et du Miocène : Données de collections du 19e siècle
Pierre LOZOUET, Bruno CAHUZAC & Laurent CHARLES
| HTML  | PDF
| PDF  [1.285 KB]
| DOI : 10.4267/2042/70761 [1.285 KB]
| DOI : 10.4267/2042/70761
|
|
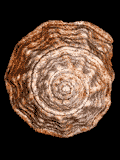 Résumé : L'examen de collections historiques déposées au Muséum
d'Histoire Naturelle de Bordeaux et à la Faculté des Sciences de l'Université
de Bordeaux a permis d'identifier de nouveaux taxons de Modulidae dans l'Oligocène
et le Miocène du bassin aquitain. Ces Modulidae appartiennent aux groupes américains
Modulus modulus et Trochomodulus.
Trois nouvelles espèces sont décrites : Modulus
benoisti nov. sp. (Serravallien), Trochomodulus
stampinicus nov. sp. (Rupélien), proche de Trochomodulus sublaevigatus (Orbigny,
1852), une espèce chattienne, et Incisilabium trochiformis
nov. sp. (Priabonien). Ce dernier est le plus ancien Modulidae connu avec Incisilabium
parisiensis (Deshayes, 1832) (Éocène moyen) précédemment classé
dans les Trochidae. Ces résultats montrent que la paléobiogéographie et
l'origine de la famille des Modulidae doivent être réexaminées. Résumé : L'examen de collections historiques déposées au Muséum
d'Histoire Naturelle de Bordeaux et à la Faculté des Sciences de l'Université
de Bordeaux a permis d'identifier de nouveaux taxons de Modulidae dans l'Oligocène
et le Miocène du bassin aquitain. Ces Modulidae appartiennent aux groupes américains
Modulus modulus et Trochomodulus.
Trois nouvelles espèces sont décrites : Modulus
benoisti nov. sp. (Serravallien), Trochomodulus
stampinicus nov. sp. (Rupélien), proche de Trochomodulus sublaevigatus (Orbigny,
1852), une espèce chattienne, et Incisilabium trochiformis
nov. sp. (Priabonien). Ce dernier est le plus ancien Modulidae connu avec Incisilabium
parisiensis (Deshayes, 1832) (Éocène moyen) précédemment classé
dans les Trochidae. Ces résultats montrent que la paléobiogéographie et
l'origine de la famille des Modulidae doivent être réexaminées.
|
|
Carnets Geol., vol. 20, nº 7, p. 125-139
En ligne depuis le 17 mars 2020
|
|
Notice nomenclaturale, p. 140
|
|
Rétablissement total des conditions marines après la phase "Lago Mare" du Messinien supérieur de la Mer Méditerranée dans les régions de Licodia Eubea et Villafranca Tirrena (Sicile orientale)
Francesco SCIUTO & Angela BALDANZA
| HTML  | PDF
| PDF  [691 KB]
| DOI : 10.4267/2042/70760 [691 KB]
| DOI : 10.4267/2042/70760
|
|
 Résumé : Après la phase dite "Lago Mare" en
Mer Méditerranée, à la fin de la crise de la salinité du Messinien supérieur, le bassin
méditerranéen s'est caractérisé par un retour à des conditions marines normales à
partir du Pliocène inférieur (Zancléen). Au cours de cette période, des accumulations remarquablement épaisses de sédiments
pélitiques calcaires très riches en foraminifères planctoniques et nannofossiles se
sont déposées dans le bassin méditerranéen. En Sicile, ces sédiments pélitiques calcaires sont connus à l'affleurement sous
l'appellation de Formation de Trubi. Comme dans d'autres régions méditerranéennes, ils
ont été déposés en concordance sur le substrat pré-Pliocène, qui est essentiellement
représenté par les évaporites messiniennes ou par des sédiments post-évaporites à
faciès "Lago Mare". Pour cette étude, nous avons analysé des échantillons récoltés dans les secteurs de
Licodia Eubea et Villafranca Tirrena (Sicile orientale) à la base de la Formation de
Trubi (Zancléen), immédiatement au-dessus du faciès messinien. Les résidus de lavages
sont caractérisés par des associations micropaléntologiques de foraminifères,
benthiques et planctoniques, et d'ostracodes typiques d'eaux profondes. Les
caractéristiques de ces associations de microfossiles et l'observation stratigraphique
des couches de la transition Messinien-Pliocène témoignent d'une élévation rapide du
niveau de la mer dans ce secteur de la région paléoméditerranéenne ; en outre, elles
sembleraient démontrer qu'ici, contrairement à ce qui a été observé sur d'autres
secteurs (e.g., détroit de Gibraltar), cet événement serait survenu sans y
produire de traces tangibles d'érosion. Résumé : Après la phase dite "Lago Mare" en
Mer Méditerranée, à la fin de la crise de la salinité du Messinien supérieur, le bassin
méditerranéen s'est caractérisé par un retour à des conditions marines normales à
partir du Pliocène inférieur (Zancléen). Au cours de cette période, des accumulations remarquablement épaisses de sédiments
pélitiques calcaires très riches en foraminifères planctoniques et nannofossiles se
sont déposées dans le bassin méditerranéen. En Sicile, ces sédiments pélitiques calcaires sont connus à l'affleurement sous
l'appellation de Formation de Trubi. Comme dans d'autres régions méditerranéennes, ils
ont été déposés en concordance sur le substrat pré-Pliocène, qui est essentiellement
représenté par les évaporites messiniennes ou par des sédiments post-évaporites à
faciès "Lago Mare". Pour cette étude, nous avons analysé des échantillons récoltés dans les secteurs de
Licodia Eubea et Villafranca Tirrena (Sicile orientale) à la base de la Formation de
Trubi (Zancléen), immédiatement au-dessus du faciès messinien. Les résidus de lavages
sont caractérisés par des associations micropaléntologiques de foraminifères,
benthiques et planctoniques, et d'ostracodes typiques d'eaux profondes. Les
caractéristiques de ces associations de microfossiles et l'observation stratigraphique
des couches de la transition Messinien-Pliocène témoignent d'une élévation rapide du
niveau de la mer dans ce secteur de la région paléoméditerranéenne ; en outre, elles
sembleraient démontrer qu'ici, contrairement à ce qui a été observé sur d'autres
secteurs (e.g., détroit de Gibraltar), cet événement serait survenu sans y
produire de traces tangibles d'érosion.
|
|
Carnets Geol., vol. 20, nº 6, p. 107-123
En ligne depuis le 17 mars 2020
|
|
Un poisson-scie rhinopristiforme (genre Pristis) de l'Éocène moyen (Lutétien) du Pérou méridional et ses implications régionales
Alberto COLLARETA, Luz TEJADA-MEDINA, César CHACALTANA-BUDIEL, Walter LANDINI, Alí ALTAMIRANO-SIERRA, Mario URBINA-SCHMITT & Giovanni BIANUCCI
| HTML  | PDF
| PDF  [1.180 KB]
| DOI : 10.4267/2042/70759 [1.180 KB]
| DOI : 10.4267/2042/70759
|
|
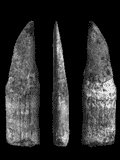 Résumé : Les poissons-scies
modernes (Rhinopristiformes : Pristidae) présentent une distribution
globale dans les eaux chaudes ; ils sont fréquents dans les habitats marins
proximaux et même en eaux douces. Le registre fossile des genres modernes des
Pristidés (i.e., Pristis et Anoxypristis) remonte à l'Éocène inférieur
et est principalement représenté par des épines rostrales isolées et dents
orales, ainsi que des rostres phosphatés représentant des événements exceptionnels.
Nous rapportons ici un rostre partiel de Pristidae, présentant plusieurs épines
rostrales articulées, provenant des couches de l'Éocène moyen de la
Formation Paracas (Membre Yumaque) exposées dans la partie
orientale du Bassin de Pisco au sud du Pérou. Ce spécimen très bien conservé permet
l'observation de structures anatomiques qui sont difficilement fossilisables,
par exemple les sillons paracentraux qui s'étirent le long de la face
ventrale du rostrum. En se basant sur la morphologie des épines rostrales, ce
poisson-scie fossile est identifié ici comme appartenant à Pristis. À
notre connaissance, cette découverte représente la plus ancienne occurrence
géologique connue de Pristidae le long des côtes pacifiques de l'Amérique du Sud. Bien
que le registre fossile des Pristidés dans la partie orientale du Bassin de Pisco
s'étende de l'Éocène moyen au Miocène supérieur, les poissons-scie ne sont plus
actuellement présents dans les eaux côtières du sud du Pérou, eaux fraîches en raison de remontées d'eaux
profondes. À la lumière des préférences écologiques des
membres actuels du genre Pristis, la présence de ce genre dans la
Formation Paracas suggère des températures de l'eau de mer plus élevées qu'actuellement
dans les environnements littoraux du sud du Pérou au cours
de l'Éocène moyen. La disparition finale des Pristidés des eaux côtières
du sud du Pérou pourrait être interprétée comme reflétant la tendance au
renforcement du courant de Humboldt au Cénozoïque supérieur. Résumé : Les poissons-scies
modernes (Rhinopristiformes : Pristidae) présentent une distribution
globale dans les eaux chaudes ; ils sont fréquents dans les habitats marins
proximaux et même en eaux douces. Le registre fossile des genres modernes des
Pristidés (i.e., Pristis et Anoxypristis) remonte à l'Éocène inférieur
et est principalement représenté par des épines rostrales isolées et dents
orales, ainsi que des rostres phosphatés représentant des événements exceptionnels.
Nous rapportons ici un rostre partiel de Pristidae, présentant plusieurs épines
rostrales articulées, provenant des couches de l'Éocène moyen de la
Formation Paracas (Membre Yumaque) exposées dans la partie
orientale du Bassin de Pisco au sud du Pérou. Ce spécimen très bien conservé permet
l'observation de structures anatomiques qui sont difficilement fossilisables,
par exemple les sillons paracentraux qui s'étirent le long de la face
ventrale du rostrum. En se basant sur la morphologie des épines rostrales, ce
poisson-scie fossile est identifié ici comme appartenant à Pristis. À
notre connaissance, cette découverte représente la plus ancienne occurrence
géologique connue de Pristidae le long des côtes pacifiques de l'Amérique du Sud. Bien
que le registre fossile des Pristidés dans la partie orientale du Bassin de Pisco
s'étende de l'Éocène moyen au Miocène supérieur, les poissons-scie ne sont plus
actuellement présents dans les eaux côtières du sud du Pérou, eaux fraîches en raison de remontées d'eaux
profondes. À la lumière des préférences écologiques des
membres actuels du genre Pristis, la présence de ce genre dans la
Formation Paracas suggère des températures de l'eau de mer plus élevées qu'actuellement
dans les environnements littoraux du sud du Pérou au cours
de l'Éocène moyen. La disparition finale des Pristidés des eaux côtières
du sud du Pérou pourrait être interprétée comme reflétant la tendance au
renforcement du courant de Humboldt au Cénozoïque supérieur.
|
|
Carnets Geol., vol. 20, nº 5, p. 91-105
En ligne depuis le 17 mars 2020
|
|
Identification d'un biohorizon d'ammonites à Romaniceras (Romaniceras) marigniacum sp. nov. (Turonien moyen) à la base du Tuffeau Jaune de Touraine (France)
Francis AMÉDRO, Francis ROBASZYNSKI, Hervé CHÂTELIER, Patrice FERCHAUD & Bertrand MATRION
| HTML  | PDF
| PDF  [3.838 KB]
| DOI : 10.4267/2042/70720 [3.838 KB]
| DOI : 10.4267/2042/70720
|
|
 Résumé : Dans le sud du Bassin de Paris, le long des vallées de la Loire et du Cher, le
Tuffeau Jaune de Touraine a été traditionnellement daté du Turonien supérieur
par la présence de très rares Romaniceras
deverianum (Orbigny, 1841). Toutefois, les quelques mètres de
tempestites à la base de la formation n'ont jamais livré d'ammonites.
Aujourd'hui, juste au sud du Turonien stratotypique, en Touraine méridionale,
la récolte de plus de 150 ammonites à la base du Tuffeau Jaune de Touraine
ainsi que dans le sommet du Tuffeau de Bourré sous-jacent apporte des précisions
significatives sur l'âge des formations. En réalité, les premiers mètres
du Tuffeau Jaune de Touraine appartiennent encore à la zone à Romaniceras
ornatissimum (Tm 3) datant le Turonien moyen. La découverte dans cet
intervalle de Romaniceras (Yubariceras)
ornatissimum (Stoliczka, 1864) associé à la nouvelle espèce Romaniceras
(R.) marigniacum Amédro & Châtelier sp. nov.
indique qu'on se trouve dans la partie élevée de la zone à R.
ornatissimum. D'autres espèces sont présentes
dans ce biohorizon :
outre Romaniceras (R.) marigniacum et Romaniceras
(Yubariceras) ornatissimum, on trouve Masiaposites
cf. kennedyi Amédro & Devalque,
2014, Collignoniceras woollgari regulare (Haas, 1946), C. turoniense (Sornay,
1951) et Collignoniceras vigennum Amédro
& Châtelier sp. nov. Résumé : Dans le sud du Bassin de Paris, le long des vallées de la Loire et du Cher, le
Tuffeau Jaune de Touraine a été traditionnellement daté du Turonien supérieur
par la présence de très rares Romaniceras
deverianum (Orbigny, 1841). Toutefois, les quelques mètres de
tempestites à la base de la formation n'ont jamais livré d'ammonites.
Aujourd'hui, juste au sud du Turonien stratotypique, en Touraine méridionale,
la récolte de plus de 150 ammonites à la base du Tuffeau Jaune de Touraine
ainsi que dans le sommet du Tuffeau de Bourré sous-jacent apporte des précisions
significatives sur l'âge des formations. En réalité, les premiers mètres
du Tuffeau Jaune de Touraine appartiennent encore à la zone à Romaniceras
ornatissimum (Tm 3) datant le Turonien moyen. La découverte dans cet
intervalle de Romaniceras (Yubariceras)
ornatissimum (Stoliczka, 1864) associé à la nouvelle espèce Romaniceras
(R.) marigniacum Amédro & Châtelier sp. nov.
indique qu'on se trouve dans la partie élevée de la zone à R.
ornatissimum. D'autres espèces sont présentes
dans ce biohorizon :
outre Romaniceras (R.) marigniacum et Romaniceras
(Yubariceras) ornatissimum, on trouve Masiaposites
cf. kennedyi Amédro & Devalque,
2014, Collignoniceras woollgari regulare (Haas, 1946), C. turoniense (Sornay,
1951) et Collignoniceras vigennum Amédro
& Châtelier sp. nov.
Le
sommet du Tuffeau de Bourré a quant à lui livré une cinquantaine
d'ammonites avec une association légèrement différente de celle connue dans
la localité type de Bourré-Montrichard dans la vallée du Cher. Le matériel récolté
près de la confluence Vienne-Creuse comprend : Lewesiceras
peramplum (Mantell, 1822),
Romaniceras (Y.) ornatissimum (Stoliczka, 1864), Collignoniceras woollgari regulare (Haas,
1946), C.
canthus (Orbigny, 1856) et C.
turoniense (Sornay, 1951). L'espèce Collignoniceras
papale (Orbigny, 1841), qui
représente un tiers des récoltes à Bourré, est apparemment absente, tandis
que trois nouvelles espèces du même genre sont identifiées : C.
hourqueigi Amédro & Châtelier sp. nov., C. badilleti Amédro
& Châtelier sp. nov. et Collignoniceras
sp. A.
|
|
Carnets Geol., vol. 20, nº 4, p. 37-89
En ligne depuis le 22 février 2020
|
|
Notice nomenclaturale, p. 90
|
|
Un nouveau cassiduloïde (Echinodermata, Echinoidea) dans l'Albien du bassin de Sergipe-Alagoas, Brésil
Cynthia L. de C. MANSO
| HTML  | PDF
| PDF  [410 KB]
| DOI : 10.4267/2042/70719 [410 KB]
| DOI : 10.4267/2042/70719
|
|
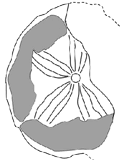 Résumé : L'article décrit la découverte de l'espèce d'échinoïde Phyllobrissus
humilis (Gauthier, 1875) dans la Formation Riachuelo d'âge
Albien du bassin Sergipe-Alagoas. Le
seul spécimen récolté provient dans l'affleurement de Maruim 1 et permet
d'observer les principales caractéristiques de l'espèce. Des informations
paléoécologiques et une clé dichotomique sont présentées pour faciliter
l'identification des espèces de cassiduloïdes du Crétacé du bassin de
Sergipe-Alagoas. Résumé : L'article décrit la découverte de l'espèce d'échinoïde Phyllobrissus
humilis (Gauthier, 1875) dans la Formation Riachuelo d'âge
Albien du bassin Sergipe-Alagoas. Le
seul spécimen récolté provient dans l'affleurement de Maruim 1 et permet
d'observer les principales caractéristiques de l'espèce. Des informations
paléoécologiques et une clé dichotomique sont présentées pour faciliter
l'identification des espèces de cassiduloïdes du Crétacé du bassin de
Sergipe-Alagoas.
|
|
Carnets Geol., vol. 20, nº 3, p. 29-35
En ligne depuis le 22 février 2020
|
|
Le dauphin à dents de requin Squalodon (Cetacea: Odontoceti) du remarquable assemblage de vertébrés marins de Montagna della Majella (Formation de Bolognano, Italie centrale)
Alberto COLLARETA, Andrea DI CENCIO, Renato RICCI & Giovanni BIANUCCI
| HTML  | PDF
| PDF  [847 KB]
| DOI : 10.4267/2042/70716 [847 KB]
| DOI : 10.4267/2042/70716
|
|
 Résumé : La
famille éteinte des Squalodontidae comprend des odontocètes de taille moyenne,
hétérodontes, présentant un long rostre qui abrite de grandes dents incisives
procombantes et de post-canines très ornées comportant des denticules
accessoires, d'où leur nom vernaculaire "dauphins à dents de requin".
Ces odontocètes longirostres sont souvent perçus comme des formes
intermédiaires comblant le fossé anatomique entre les odontocètes oligocènes
archaïques et leurs parents du Miocène tardif jusqu'à l'Holocène.
Probablement parmi les principaux prédateurs marins de leur époque, les
dauphins à dents de requin sont d’importants éléments au sein de plusieurs
assemblages de mammifères marins du Miocène inférieur des domaines
nord-atlantique et méditerranéen/para-téthysien. Dans le présent travail, un
crâne partiel de Squalodontidae est décrit dans les couches de la Formation de
Bolognano affleurant dans le secteur nord-est du massif de Montagna della
Majella (Abruzzes, Italie centrale), qui a livré par le passé un riche
assemblage de vertébrés marins du Miocène inférieur, comprenant onze taxons
d'élasmobranches, ainsi que des téléostéens moins nombreux et des restes
très fragmentaires de reptiles et de mammifères marins. Ce spécimen comprend
la partie antéro-dorsale du rostre, comportant des parties des deux
prémaxillaires et du maxillaire gauche, et les sept dents supérieures gauches
les plus antérieures. Ce crâne partiel est identifié ici comme appartenant au
genre Squalodon, dont la présence dans l'assemblage de vertébrés de
Montagna della Majella avait déjà été proposée provisoirement sur la base
de deux dents fragmentaires. La signification paléontologique de cette
découverte est discutée dans le contexte plus large du registre euro-méditerranéen
du genre Squalodon. Résumé : La
famille éteinte des Squalodontidae comprend des odontocètes de taille moyenne,
hétérodontes, présentant un long rostre qui abrite de grandes dents incisives
procombantes et de post-canines très ornées comportant des denticules
accessoires, d'où leur nom vernaculaire "dauphins à dents de requin".
Ces odontocètes longirostres sont souvent perçus comme des formes
intermédiaires comblant le fossé anatomique entre les odontocètes oligocènes
archaïques et leurs parents du Miocène tardif jusqu'à l'Holocène.
Probablement parmi les principaux prédateurs marins de leur époque, les
dauphins à dents de requin sont d’importants éléments au sein de plusieurs
assemblages de mammifères marins du Miocène inférieur des domaines
nord-atlantique et méditerranéen/para-téthysien. Dans le présent travail, un
crâne partiel de Squalodontidae est décrit dans les couches de la Formation de
Bolognano affleurant dans le secteur nord-est du massif de Montagna della
Majella (Abruzzes, Italie centrale), qui a livré par le passé un riche
assemblage de vertébrés marins du Miocène inférieur, comprenant onze taxons
d'élasmobranches, ainsi que des téléostéens moins nombreux et des restes
très fragmentaires de reptiles et de mammifères marins. Ce spécimen comprend
la partie antéro-dorsale du rostre, comportant des parties des deux
prémaxillaires et du maxillaire gauche, et les sept dents supérieures gauches
les plus antérieures. Ce crâne partiel est identifié ici comme appartenant au
genre Squalodon, dont la présence dans l'assemblage de vertébrés de
Montagna della Majella avait déjà été proposée provisoirement sur la base
de deux dents fragmentaires. La signification paléontologique de cette
découverte est discutée dans le contexte plus large du registre euro-méditerranéen
du genre Squalodon.
|
|
Carnets Geol., vol. 20, nº 2, p. 19-28
En ligne depuis le 22 février 2020
|
|
Un regard critique sur Tré Maroua (Le Saix, Hautes-Alpes, France), la coupe candidate pour le PSM du Berriasien
Bruno R.C. GRANIER, Serge FERRY & Mohamed BENZAGGAGH
| HTML  | PDF
| PDF  [2.966 KB]
| DOI : 10.4267/2042/70714 [2.966 KB]
| DOI : 10.4267/2042/70714
|
|
 Résumé : Le site de Tré Maroua en
SE France a récemment été sélectionné par le Groupe de Travail Berriasien
de la Sous-Commission Internationale de Stratigraphie du Crétacé comme la
localité candidate pour la coupe de référence du Point Stratotypique Mondial
(PSM) du Berriasien. Cependant, sur la base de nos recherches préliminaires
effectuées sur ce site et dans les environs, il apparaît que cette coupe est paléogéographiquement située sur un paléotalus profond comportant des
surfaces d'érosion emboîtées, des hiatus stratigraphiques importants et des
brèches de resédimentation. Elle ne répond pas à au moins quatre des cinq
"exigences géologiques pour un PSM". Par conséquent, à notre avis,
sa candidature devrait être définitivement écartée. Résumé : Le site de Tré Maroua en
SE France a récemment été sélectionné par le Groupe de Travail Berriasien
de la Sous-Commission Internationale de Stratigraphie du Crétacé comme la
localité candidate pour la coupe de référence du Point Stratotypique Mondial
(PSM) du Berriasien. Cependant, sur la base de nos recherches préliminaires
effectuées sur ce site et dans les environs, il apparaît que cette coupe est paléogéographiquement située sur un paléotalus profond comportant des
surfaces d'érosion emboîtées, des hiatus stratigraphiques importants et des
brèches de resédimentation. Elle ne répond pas à au moins quatre des cinq
"exigences géologiques pour un PSM". Par conséquent, à notre avis,
sa candidature devrait être définitivement écartée.
|
|
Carnets Geol., vol. 20, nº 1, p. 1-17
En ligne depuis le 22 février 2020
|
|
|
|